|
|
N.B.
Cet ARTICLE remplace et
amplifie "Cabildos de nation carabalí à Santiago de Cuba"
mis en ligne le 11/12/2014.
Daniel Mirabeau : percussionniste, chanteur et saxophoniste, il s'est formé dans l'Oriente cubain aux traditions carnavalesques et aux cultures haïtiennes. Après quelques séjours à Cuba avec Ritmacuba (à Santiago) ou Trempolino (à La Havane), il effectue in situ son parcours personnel auprès de différents maîtres. Il enseigne les musiques cubaines et haïtiennes à l'Ecole Municipale de Musique de Pierre Bénite (Rhône) et lors de stages avec toutes sortes de publics (non-musiciens, enfants, scolaires).

Carabalí
Olugo,
Festival del Caribe 2013 © Daniel Chatelain
INDEX.
1. De l'esclavage et son expansion à Cuba
2. L'économie de plantation à Cuba au XVIII et XIXe siècle
3. Les nations d'esclaves issues de la traite transatlantique
5. Les barracones, palenques et cofradías, du lieu de vie des esclaves aux rassemblements illégaux.
6. Les cabildos de nation à Cuba
6.1. Les premiers cabildos
6.2. Qui au sein des cabildos : Noirs libres ? Esclaves ?
6.3. Hiérarchie, activités et patrimoine des cabildos
6.4. Cabildos et confréries, législation et mises en application locales
7. Situation des Noirs libres dans la société cubaine esclavagiste
9. Les cabildos de nation de la partie orientale de Cuba avant la loi sur les associations
10. Les cabildos de nation carabalí d'Oriente avant l'abolition de l'esclavage
11. Déclin des cabildos de nation et durcissement de la législation
12. Abolition de l'esclavage et les religions dans le Cuba moderne
13. Les comparsas carabalí encore en activité à l'époque moderne
13.3. Autres cabildos carabalí après l'indépendance de Cuba
14. Séquençage d'un défilé carabalí
16. Instrumentarium musical des comparsas carabalí
17. Les chants des comparsas carabalí de Santiago
Remerciements
Notes
Dans les carnavals de l'Est de Cuba,
les comparsas carabalí sont parmi les plus anciens
groupes de défilé de l'île. Assister à une de leur prestation
est un évènement qui ne laisse pas indifférent. Des chants au
parfum d'Espagne sur des rythmes africains, des danses
ressemblant à celles des cours royales européennes, un bien
curieux mélange... Ces formations carabalí sont dites centenaires.
Elles sont en réalité plus anciennes et se confondent avec
l'histoire des premières manifestations carnavalesques et de
l'esclavage à Cuba.
Avant d'aborder les
défilés carabalí contemporain, il convient de les
contextualiser sous l'angle de leur origine ethnique, en
retracer l'histoire. Nous placerons notre étude sur la partie
orientale de l'île de Cuba, là où subsistent encore des
manifestations de ces comparsas carabalí.

Monument en hommage aux Nègres Marrons, Alberto Lescay, El Cobre (province De Santiago de Cuba)
On ne peut évoquer des éléments de culture africaine à Cuba sans aborder
la question de l'esclavage. Les premiers esclaves africains
sont débarqués d'Haïti vers Santiago de Cuba en 1521. Ils
seront employés pour la plupart dans les mines de cuivre du
Cobre[1]
.
Trois éléments déterminent le développement particulier de l'esclavage
sur l'île : l'extermination des populations indiennes, des
terres fertiles et accessibles, une politique de travail
insulaire efficiente[2]
. Détaillons quelque
peu chacun de ces points.
La violence et la barbarie des conquistadores
n'expliquent pas l'éradication des populations indigènes. La
charge virale exogène des colons espagnols suffira à décimer les
Indiens. Comme sur d'autres territoires de l'empire et face à
une main d'œuvre en voie de disparition, les Espagnols vont
contribuer au développement du trafic d'esclave transatlantique,
de l'Afrique de l'Ouest en direction de leurs comptoirs et
colonies.
L'essentiel des ressources à Cuba seront des terres fertiles
favorables au développement de l'agriculture. Il y eût aussi des
mines de cuivre dans la partie orientale, mais d'un faible
intérêt au regard d'autres territoires de l'empire fournissant
des métaux précieux pour la Couronne d'Espagne. C'est
véritablement l'essor du marché du sucre qui va faire s'emballer
le commerce négrier transatlantique à Cuba, à partir du XVIIIe
siècle.

Coupe de la canne à sucre, Luis Patricio Landaluze, 1874, Musée des Beaux-Arts, La Havane
La troisième raison du développement considérable de l'esclavage
à Cuba, c'est une organisation du travail insulaire très
efficace et régie par le pouvoir colonial. Même si elle ne
représente qu'une zone minuscule de l'empire espagnol, Cuba sera
l'une des principales colonies importatrices d'esclaves.
L'essentiel de la législation sera calqué sur le Code Noir
français[3].
La couronne espagnole interdira à ses compagnies d'affréter des
navires dédiés au transport d'esclaves. Cette cédule royale sera
détournée de manière totalement hypocrite : les esclaves
seront achetés tout d'abord aux portugais, puis aux anglais et
hollandais. Des mesures libérales insulaires vont en ce sens
favoriser l'aristocratie havanaise.
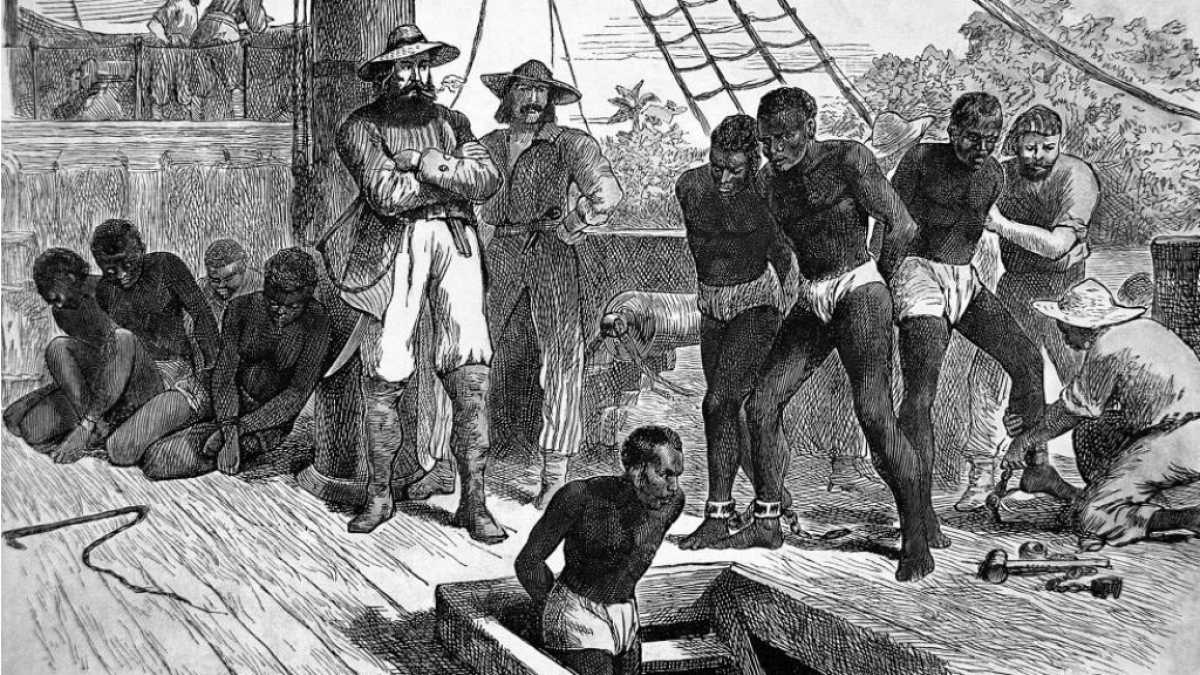
Chargement d'un navire négrier, auteur inconnu
Il est quasiment impossible de comptabiliser de manière
définitive le nombre d'esclaves africains qui furent déportés
vers Cuba, tant le trafic clandestin continua dans la zone
caribéenne et des Amériques. Néanmoins, on peut comptabiliser un
chiffre global de 1 318 000, du début de la traite
légale jusqu'à 1873[4].
Cependant, du début de sa colonisation par les Espagnols jusqu'à
la fin du XVIIIe s., Cuba
demeure une destination minoritaire du commerce négrier
caribéen : 32 000 esclaves en 1763, dix fois moins
qu'en Jamaïque et vingt fois moins qu'à Saint-Domingue à la même
date.
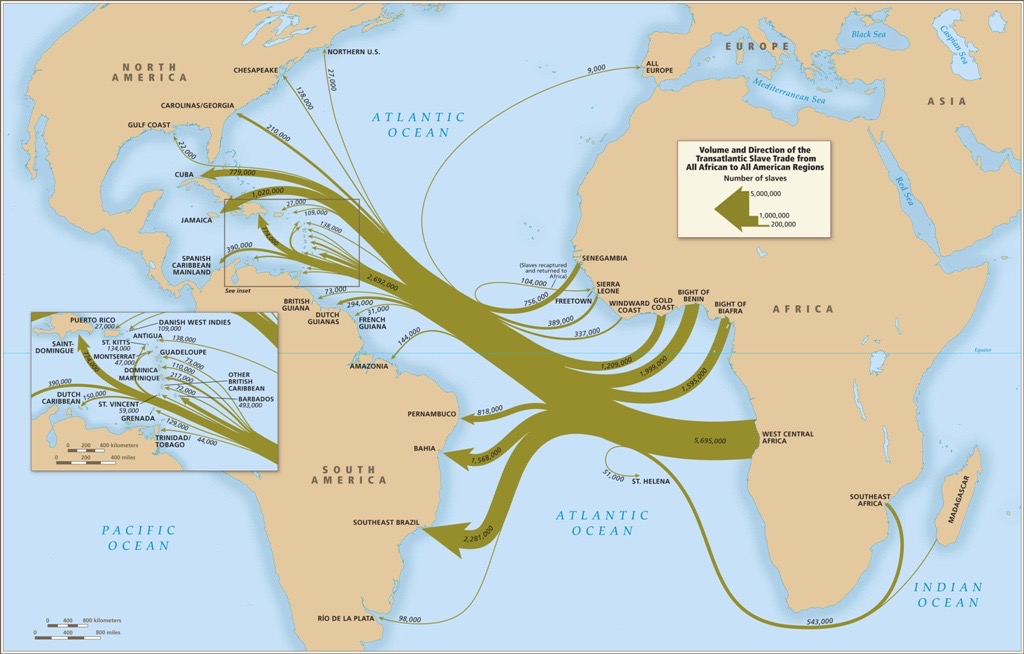
Volume
et direction du trafic transatlantique d'esclaves © David Eltis
& David Richardson
La cédule royale de 1789[5]
va marquer l'amorce d'un commerce d'esclaves à grande échelle,
condition indispensable au développement de l'économie de
plantation à Cuba.
D'immenses terres fertiles à proximité des
côtes vont permettre l'expansion du commerce portuaire. Jusqu'au
XIXe siècle, l'essentiel des exploitations agricoles
se réduisait à de l'élevage bovin destiné à la boucherie et au
trait, du tabac, les cultures de café et de sucre restaient
encore confidentielles au regard de ce qu'elles deviendront au
siècle suivant.

Culture sucrière à Cuba au XIXe s., auteur inconnu
Á la fin du XVIIIesiècle, les planteurs de Saint-Domingue fuient les révoltes d'esclaves et s'installent pour la plupart dans la partie orientale de Cuba. Leur savoir-faire agronomique va contribuer au boom économique grâce à l'industrie sucrière et dans une moindre mesure, celle du café.
Cuba devient alors la nouvelle "perle des Antilles", avec un négoce prospère et moderne nécessitant toujours plus d'esclaves. Malgré l'abolition de l'esclavage en 1880, le trafic négrier continuera illégalement jusqu'au début de la première guerre d'indépendance (1868)[6].Le développement de l'économie sucrière pousse à la recherche constante
de nouvelle main d'œuvre. Le fait que celle-ci soit esclave ou
non importait finalement peu, pourvu qu'elle soit docile et bon
marché. Après l'abolition, ce seront des blancs sans-terre et
sans droits civiques, des Chinois sous contrat. Plus tard, ce
seront des européens et des caribéens dans une moindre mesure[7].
La liberté ou non de ces travailleurs agricoles ne laisse
présager en rien de leur traitement ou condition de vie.
Les populations africaines déportées à Cuba pour la traite
étaient consignées dans des registres d'état. On les distinguait
avec des toponymes et hydronymes qui les identifiaient en
fonction de leur aire fluviale et maritimes
de provenance. Dans une moindre mesure, les dénominations
ethniques adoptées correspondaient à des filiations
linguistiques[8].
La provenance et la quantité d'esclaves débarqués va
varier selon les époques. Il y aura durant toute la période
esclavagiste, c'est-à-dire jusqu'à 1886, un classement de
ceux-ci par méta-ethnie, qui prédéterminera leur prix et leur
fonctionnalité.
On dénombre donc huit méta-ethnies, chacune avec une
multitude de subdivisions dont les appellations vont varier
selon les époques[9] :
- Les arará, du Ghana, Bénin, Nigéria, Togo.
- Les carabalí (cf. chap. 2)
- Les congo[10]
des zones actuelles du Zaïre, Congo Brazzaville, Ouganda, du
Gabon, de l'Angola et de la Zambie. De loin la plus grande zone
géographique de prélèvement d'esclaves.
- Les gangá, de Guinée Bissau, de Sierra Leone, de
Guinée, du Liberia, du Sénégal, de la Gambie, du Mali, de la
Mauritanie.
- Les lucumí du Nigéria et du Bénin. L'une des ethnies dont la
culture est la plus visible à Cuba. Feront partie des dernières
populations esclavagées sur l'île.
- Les mandinga de Sierra Leone, de Guinée, du Liberia, du Mali,
de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Sénégal, de
Guinée-Bissau, du Nigeria (nord), du Cameroun (nord), du
Niger, du Bénin (nord), du Cap-Vert, du Ghana, du Tchad, de
Mauritanie ou du Togo.
- Les mina, du Ghana, du Liberia, du Sud du Maroc.
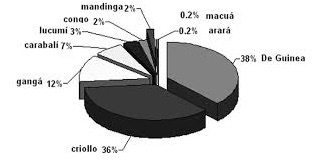
Ethnies africaines esclavagées à Cuba au XIXe s.
Les carabalí sont des populations originaires de la région
sud-orientale du Nigéria actuel. Cette toponymie viendrait de la
déformation du mot calbary[11]
utilisé dans le jargon des marchands d'esclaves anglais pour
désigner la multitude des esclaves commercialisés depuis la côte
et sur les bords du fleuve Calabar[12].
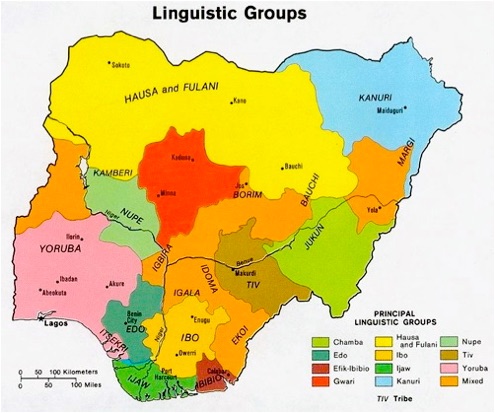
Carte linguistique de la zone du Calabar et du delta du Niger
En effet, si ces populations étaient embarquées à destination de l'aire
caribéenne dans les ports du Calabar, elles étaient originaires
de nombreuses ethnies, comprenant :
-Les ekoi ou ejagham (Cameroun occidental et
pointe orientale du Nigéria). Les sociétés masculines ekpe
viennent de cette ethnie, à l'origine des confréries secrètes abakuá
à Cuba.
-Les ibibio ou agbishera (Nigeria sud-oriental ;
Cameroun et Guinée équatoriale en infime partie)
-Les igbo (ethnie principale de la partie Sud-Est du
Nigeria et du Cameroun en infime partie),
-Les ijo ou ije (delta du Niger, de la partie
sud-orientale du Nigeria et du Cameroun en infime partie)[13].
La traite de ces populations
débute au XVIe s. avec les Portugais, essentiellement
en direction du Brésil, puis les Anglais à partir de 1626. Elles
feront partie des premières vagues d'esclaves.
À cette époque, les carabalí étaient acheminés
majoritairement en direction des Antilles britanniques (Barbade,
Antigua, Grenadines, Saint Kits, Dominique et dans une moindre
mesure la Jamaïque), de Saint Domingue[14]
et Porto Rico pour les possessions espagnoles. A Cuba, on ne
recense que 336 esclaves du Calabar entre 1651 et 1675 pour 2741
dans le reste des Antilles espagnoles et 43 634 pour l'ensemble
des possessions britanniques. L'arrivée des carabalí à
Cuba est plus significative à partir de 1751.
Dans son ensemble, la traite cubaine connaîtra un pic de 122 957
personnes entre 1826 et 1850. Elle déclinera à partir de 1867,
où la couronne espagnole met fin à la traite transatlantique.
Elle continuera avec un trafic caribéen jusqu'à l'abolition de
l'esclavage en 1886[15].
Un dicton connu à Cuba constitue un raccourci sur les racines
africaines de ses habitants :
" Ici, celui qui n'est pas de sang congo est de sang carabalí"
[16].
Le poème de Nicolás Guillén nous dit à peu près la même
chose : « Yoruba je suis, je suis Lucumi, Mandingue,
Congo, Carabali, Écoutez mes amis, c'est comme ça : Nous
sommes ensemble de loin, jeunes, vieux, noirs et blancs, tous
mélangés »[17].
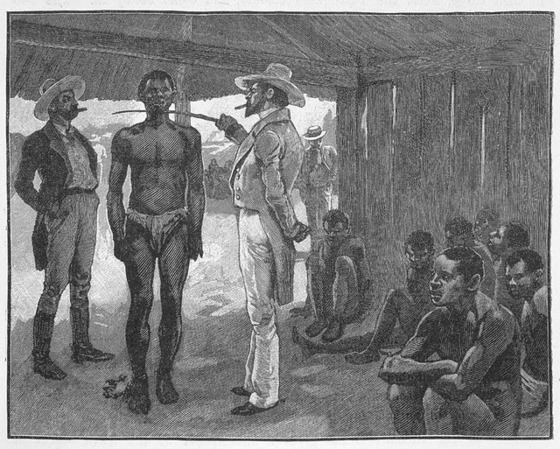
L'achat d'esclaves, gravure, 1837, auteur inconnu
Entre 1823 et 1855, la région de Santiago de Cuba compte 27,1 %
de carabalí, 35 % de bantú (congo), 16 % de mandinga
(essentiellement du Sénégal et du Mali) et 28 % d'autres
ethnies (lucumí, maní, indéfinis)
On va observer une baisse des carabalí dans la traite négrière sur la deuxième moitié du XIXe siècle. Ils deviennent minoritaires, au profit des congo, gangá et lucumí. La présence peu marquée d'éléments carabalí dans la culture cubaine contemporaine s'explique par leur faible quantité d'importation dans la dernière période de la traite légale.
Différents vocables et leurs nuances existaient à l'époque
coloniale pour désigner des rassemblements de Noirs. Souvent la
locution définissant le groupe humain est la même que celle
désignant l'aire de pratique cultuelle, qu'elle soit à l'intérieur
d'un édifice, ou en plein air. Cette diversité sémantique reflète
la multiplicité de statut social de l'homme Noir dans la société,
au travers l'histoire de l'esclavage à Cuba.

Barraquement
d'esclaves à Sancti Spiritu © Oscar Alfonso

Scène de plantation sucrière, esclaves devant un baraquement à Cuba, 1870 © E& H.T Anthony
Les activités des Noirs sur le batey ne sont soumises à un cadre juridique, mais à la seule loi du maître. La justice coloniale intervient parfois pour sanctionner la tenue de fêtes d'esclaves jugées scandaleuses. En 1817, le tribunal de Santiago de Cuba exige d'un planteur de s'acquitter d'une amende pour avoir autoriser une cérémonie vodou sur ses terres. Les principaux participants seront emprisonnés ou fouettés[19]. On peut supposer que certains barracones jouissaient d'un certain prestige hors de la plantation, mais il y avait peu de perméabilité de l'un à l'autre. Leurs activités et festivités restaient à destination des seuls esclaves de la propriété.
Si les barracones ne sont
pas soumis à une législation d'état, le code noir, ainsi que les
arrêtés du gouverneur et des administrateurs des provinces vont
encadrer la vie et le commerce des esclaves.
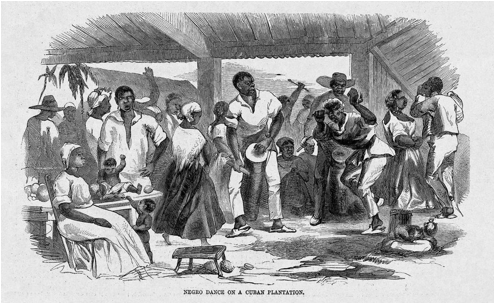
Danse de Noirs d'une plantation cubaine, publié dans le Harper's Weekly, 29 janv. 1859

Image du film Maluala, Sergio Giral, 1979. Maluala était l'un des principaux palenques de la partie orientale de Cuba
A la fin du
XVIIIe s., la propension d'esclaves en fuite passe
d'actes isolés à de véritables mouvements de rebellions dans
plusieurs colonies de la zone caribéenne. Le marronage, acte de
reprendre sa liberté, gagne toute l'île de Cuba. Ces esclaves
fugitifs, ou cimarrones, mèneront une véritable guerre
contre la société esclavagiste tout au long de la première
moitié du XIXe s.[20].
Parmi les mouvements les plus importants dans la zone orientale,
les esclaves des mines du Cobre se rebellent massivement dès
1731. A Bayamo, une conspiration est menée en 1795 par le cimarrón
Nicola Morales qui s'allie avec des Créoles et des Blancs[21].
Certains cimarrones se regroupaient en communautés, que
l'on désignait par le terme de palenque. A l'écart des
routes, cachées dans la forêt vierge, c'était parfois de
véritables villages fortifiés, clôturés de palissades, avec ses
maisons d'habitations, réserves de nourriture et aires
d'assemblée. Le palenque du Frijol, situé dans la Sierra
Maestra à l'intersection des rivières Jaguaní et Toa, fût le
plus connu et compta jusqu'à 200 habitations et 300 âmes. Après
plusieurs tentatives infructueuses, il fut détruit et ses
habitants massacrés par l'armée en 1816[22].
Le palenque désigne à la fois le village et la
communauté. Par extension, il est aussi le mot désignant l'aire
de culte et de festivités fréquentée par les cimarrones.
Malgré la liberté à l'intérieur du village, les déménagements
sont fréquents pour échapper aux chasseurs d'esclaves (rancheadores).

El cimarrón, Luis Patricio Landaluze, circa 1860
Depuis 1578, existaient différents regroupements de Noirs à Cuba
avec différentes visées : religieuses, récréatives,
entraide, ou tout cela à la fois. A partir de 1758, le
gouverneur met en application une cédule royale ordonnant la
séparation ethnique au sein de ces groupements et interdit leur
fréquentation par les Créoles. Les autorités coloniales cubaines
reproduisent alors le modèle de ce qui se pratiquait déjà à
Séville avant la découverte des Amériques. Les cabildos
de nation à Cuba auront toujours deux tutelles, celles l'Etat et
de l'Eglise.
Les autorités coloniales cubaines regroupèrent par ethnies les
Noirs amenés d'Afrique en suivant le modèle de ce qui se
pratiquait déjà à Séville avant la découverte des Amériques.
Dans son sens premier, le mot cabildo définit une une
institution civile espagnole incarnant le pouvoir local. Le
second est celui d'une une réunion administrant un ordre
religieux. Les cabildos de nation à Cuba auront
toujours ces deux tutelles, l'Etat et l'Eglise. La définition du
cabildo diffère selon les époques, juridictions et
auteurs.
Pour Esteban Pichardo, géographe et linguiste dominicain du XIXe
s., le terme de cabildo désigne
« une assemblée de Noirs d'Afrique de même nation, bruyante et
festive sans véritable existence juridique »[24].
Au sens figuré, il la définit une « réunion inepte où règne le
désordre »[25].
Cette vision superficielle et partiale du cabildo était
vraisemblablement ancrée dans l'opinion générale de la société
coloniale cubaine de l'époque.
Pour Pedro Deschamps Chapeaux, historien cubain contemporain, « c'est un
regroupement de Noirs africains appartenant à la même nation ou
tribu dont le rôle était l'entraide mutuelle, le secours en cas
d'infirmité ou de mort, et de maintenir en vie le souvenir de la
patrie lointaine et perdue au moyen de la pratique de sa propre
religion, de l'usage de sa langue, les chants et la musique ».
Jusqu'en 1880, on va dénombrer 72 cabildos de nation
dans les registres d'état pour toute l'île de Cuba.
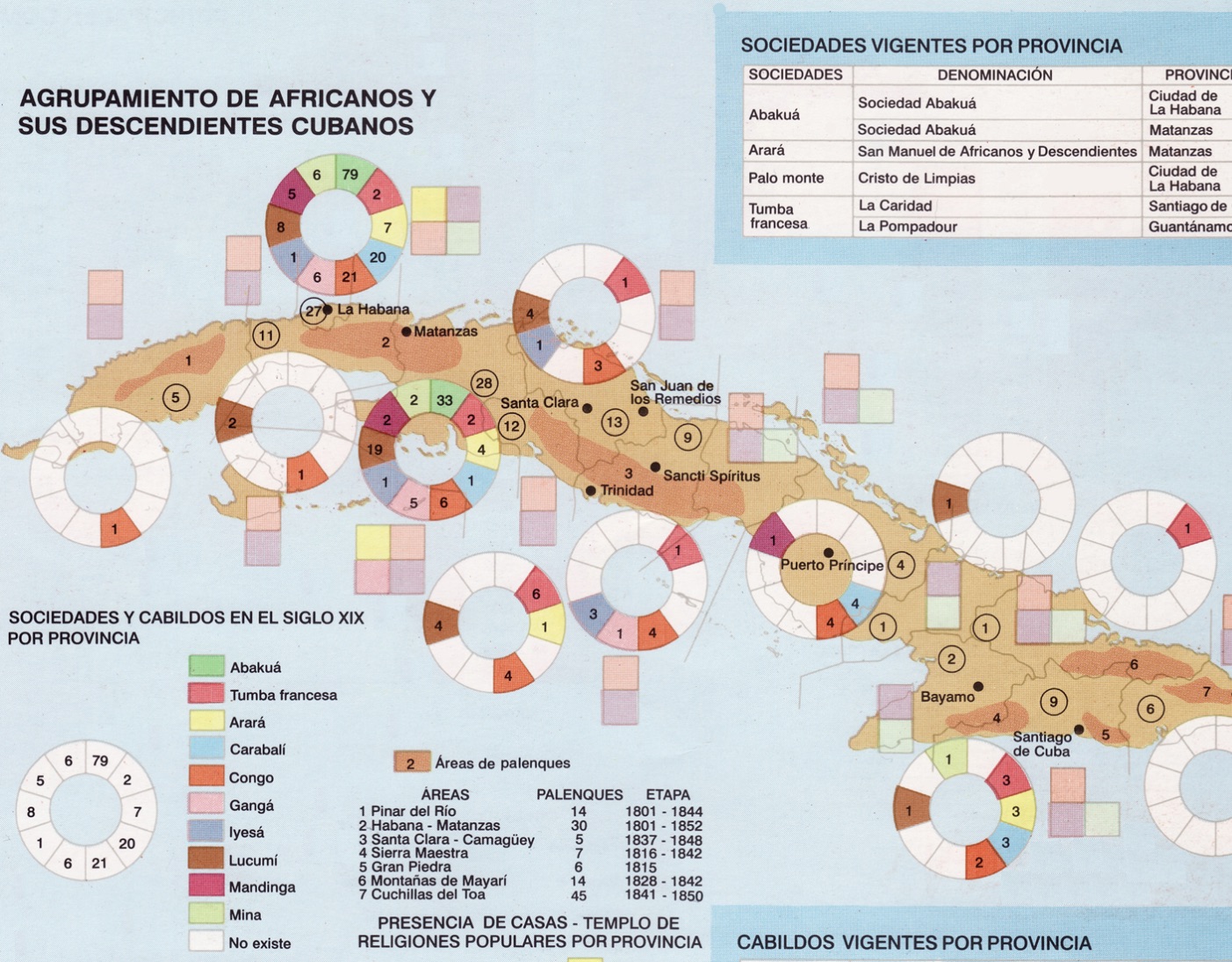
Carte des principaux cabildos au XIXe s., CIDMUC, Atlas ethnographique de Cuba, 1998, Ed.Cubarte
On trouve la trace de ces cabildos de nation dès la colonisation de Cuba. Le premier de la partie occidentale aurait été fondé à La Havane en 1568. Certains le nomment Cabildo Shango, ce qui signifierait de nation lucumí, chose étonnante au regard des arrivages d'esclaves de l'époque. Un autre document de 1598 atteste de la naissance de la confrérie de gens de couleur mina zape, de nation mina, consacré à Nuestra Señora de Los Remedios[26]. Cependant l'existence des cabildos n'est attestée qu'en 1755 dans les documents de l'épiscopat havanais[27].
Pour la partie orientale, les registres épiscopaux parlent d'un cabildo
congo en 1616 à Santiago de Cuba. Cependant, une trace
antérieure existe dès 1535, avec une plainte de voisinage
enregistrée sur une main courante de l'administration : une
habitante vient protester du raffut qu'effectue le roi congo
et les comparses de sa confrérie, avec force tambours et chants[28].
Ce cabildo congo est qualifié par Barcia de macro-cabildo,
car il comprenait au XVIIIe s. plusieurs sites
disséminés sur la ville. Il avait de l'importance dans la vie
locale, le couronnement ou la mort de ses rois étant chroniqué
par la presse. Le cabildo congo exerçait par ailleurs un
pouvoir non officiel sur tous les autres. Le roi congo était le
seul régulièrement consulté par les autorités pour entre autres
l'organisation des sorties carnavalesques.
Il y avait également à La Havane, Matanzas et Camagüey des « cabildos
de cinq nations ». Dans le cas de La Havane, ce macro-cabildo
constituait une instance supérieure non enregistrée auprès des
autorités, auprès de laquelle se tournaient les dirigeants des
cabildos pour faire face à des problèmes communs et ériger
des sanctions[29].
Á Matanzas le cabildo de cinq nations est officiel. Même
si certains le nomment cabildos de cinq nations, le cas
de Camagüey est encore différent, car réunissait uniquement des
carabalí de différentes ethnies. Comme nous le verrons
plus tard, cette situation ne durera pas et le cabildo
sera scindé en deux face aux dissensions inter-ethniques.

Trône et artefacts de pouvoir du roi du cabildo congo, musée de Santiago de Cuba
Jusqu'au XIXe s., n'étaient acceptés dans les cabildos que les Noirs bossales[30], c'est-à-dire nés en Afrique, ce qui excluait les Créoles de la Caraïbe. Le terme de bossales ne présume pas qu'ils soient des hommes libres ou esclaves à Cuba, mais signifie leur venue comme esclave africain. La séparation obligatoire des ethnies par nation au sein des cabildos était un moyen de contrôle du pouvoir colonial. Il entretenait ainsi les rivalités déjà existantes en Afrique de peuples ennemis, par les guerres menées les uns contre les autres, ou par les haines attisées par le commerce négrier. En effet, des marchands européens hésitaient à s'aventurer dans les terres et payaient certains peuples africains pour obtenir des esclaves.
A partir du XIXe s. et selon la zone géographique, il existe
plus de permissivité concernant la mixité ethnique, en
particulier avec les créoles[31].
En 1866, un roi congo de Santiago de Cuba proteste
énergiquement auprès des autorités contre un cabildo mélangeant
créoles et africains pour qu'ils n'entrent pas à l'église pour
obtenir la bénédiction[32].
Le manque de permissivité n'est donc pas le fait uniquement des
autorités coloniales, il en va des luttes de pouvoir entre cabildos
et entre ethnies.
Quel était le statut des membres des cabildos? Esclaves
ou hommes libres? Visiblement les deux étaient représentés, mais
dans des quantités et des statuts qui diffèrent selon les
époques et les régions. Dès le XVIIIe siècle, la
présence d'esclaves y était marginale et mal perçue. Pour la
plupart, les colons n'autorisaient pas à leurs esclaves
fréquenter les cabildos. Dans la pratique, ils s'y
glissaient à leur insu.
Dans tous les cas, c'était à l'individu de faire la demande d'intégrer un
cabildo, cela n'avait rien d'obligatoire. L'examen des
lois de la couronne espagnole nous donne des pistes. A Séville
en 1526, une 'cédule royale' permet le rachat par l'esclave ou
une tierce personne de sa liberté, en devenant affranchi[33].
Cette loi avait cours pour les cabildos du Sud de
l'Espagne au XVIe, constitués d'anciens esclaves
affranchis. Cette loi fût-elle appliquée à Cuba?
Carmen Barcía nous dit que « bien que légalement ses membres eussent à
être africains libres, la plupart était arrivés comme des
esclaves ; cette circonstance passée les compromettaient d'une
certaine façon et aussi les encourageaient à procurer
l'émancipation de leur amis ou parents qui restaient dans un
état de servitude »[34].
Plus loin, « Dans les cabildos havanais, les esclaves
apparaissent toujours comme des éléments subordonnés et
manipulés par les différents groupes qui intégraient chaque
société ».
Perrera Diaz propose une thèse similaire : « une participation des
esclaves aux cabildos et la contribution de la part de
tous ses membres à la manumission de ceux qui le nécessitaient »[35].
La manumission est un terme juridique qui date du moyen-âge. Il
consistait pour un seigneur envers son serf, un père envers son
fils, ou un maître envers son esclave, à poser les deux mains à
plat sur la tête de ce dernier, qui se tenait à genoux devant
lui, devant témoins. La personne était alors affranchie ou
émancipée, un notaire l'attestait par un document écrit.
Parfois, les cabildos rachetaient la liberté de leurs membres les
plus méritants. Ce sera le cas par exemple de Ramon Granda
responsable du cabildo viví de Santiago, qui rachète la
liberté de sept esclaves en 1824.
Pour Luisa Martinez O'Farill, concernant les cabildos havanais,
seuls les esclaves domestiques avaient pour des raisons de
proximité la possibilité de fréquenter les cabildos, tous
situés en ville.
À Santiago dès le XVIIIe s.,
la présence d'esclaves dans les cabildos était marginale
et mal perçue. Les propriétaires n'autorisaient pas ouvertement
leurs esclaves à les fréquenter[36].
Les membres des cabildos sont pour la plupart des
d'hommes ayant retrouvés légalement leur liberté, ou directement
nés libres[37].
Dans la pratique, des esclaves participaient non officiellement
aux activités des cabildos, où ils étaient tolérés en
fonction de leur couleur de peau. Les créoles et mulâtres en
étaient exclus, ainsi que les Noirs d'autres ethnies.
Les spécificités de législation concernant le statut des membres des cabildos de nation dans les localités orientales de Cuba s'explique par la proximité avec Saint-Domingue et la Jamaïque. Les mouvements de lutte des marrons dans ces pays exerceront une influence particulière sur l'attitude des colons espagnols. Le produit d'une partie de la traite jamaïcaine est revendu aux propriétaires terriens cubains. A la Jamaïque, les Anglais concèdent en 1739 trois parties autonomes de l'île aux marroons. En Haïti, des mouvements de révolte importants malmènent les propriétaires terriens dès la fin du XVIIIe s., jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1793.
Dans la partie orientale, les colons n'étaient pas favorables à ce que les esclaves créoles et bossales ayant transité par la Jamaïque et Haïti viennent se mélanger aux libertos dans les cabildos, au risque de créer des foyers de sédition.
De manière générale, le statut d'esclave, celui d'homme libre, la mixité des deux et leur proportion dans les cabildos de nation reste à ce jour un sujet de polémiques et un terrain d'étude encore fécond sur lequel toutes les études ne s'accordent pas.
Les cabildos étaient organisés selon une hiérarchie en référence à la couronne espagnole. A la tête de la communauté était nommé un roi. C'était la plupart du temps le doyen du cabildo, ou une personne de rang royal ou de chefferie africaine, ou un dignitaire religieux dont la liberté avait pu être rachetée par la caisse du cabildo. Le roi était selon les cas, élu à vie (en Oriente) ou à l'issue d'un vote effectué tous les quatre ans sous le contrôle d'un fonctionnaire d'Etat (à La Havane). Il était également le référent et porte-parole pour les relations avec les autorités. Des contremaîtres (mayorales[38]) et majordomes organisaient les activités du cabildo. On notera que ces appellations correspondent à celle de la propriété coloniale, où le contremaître veille à l'organisation du travail des champs et le majordome à celle de l'activité domestique.
Dans certains cabildos, les femmes étaient admises et avaient également leur place dans l'organisation hiérarchique, avec une reine à leur tête. Les cabildos deviennent progressivement matriarcaux après 1880. Le titre de roi disparait au profit de la reine. L'assesseur des affaires noires du gouverneur de Santiago édicte un règlement en 1827 régissant les modalités électorales des postes à responsabilités des cabildos et les restrictions pour les esclaves à participer à leurs activités.
Les cabildos les plus anciens et les plus prospères possèdent un réel pouvoir économique : rachat de la liberté de ses membres, achats d'indulgences pour les fêtes, achats immobiliers, rôle dans la constitution de solares[39]. Pour exemple, un cabildo arará magino de La Havane achète en 1795 quatorze chambres dans un immeuble et s'y réserve une salle pour ses fêtes et cérémonies[40]. Certains membres des cabildos possèdent même des esclaves, des biens immobiliers. En 1870, Juan Bertault et sa femme, ex-esclaves, possèdent 30 921 pesos. Ils furent accusés de captation d'héritage au sein d'un cabildo, utilisant des faux-témoignages de ses subalternes[41].
Si l'on ordonne les aspirations, de la plus officielle aux non-dits, elles étaient d'ordre sociale (entraide, secours), récréative, culturelle (préservation d'un patrimoine) et cultuelle. Le marqueur le plus pertinent pour caractériser un cabildo est sa pratique religieuse. A travers elle s'exprime son imaginaire, son histoire et son art. C'est pourtant l'aspect religieux qui sera le plus occulté dans les cabildos, pour échapper aux tensions avec l'église et à la politique répressive du pouvoir colonial. Les cultes africains devaient rester confidentiels, les services funèbres interdits hors du cadre de l'église.
Pour autant, les activités de distraction et d'entraide était considérée avec bienveillance ou indifférence par les colons. Au même titre que d'autres cabildos de nation, les carabalí étaient autorisés à défiler le Jour des Rois (6 janvier) avec leurs costumes, leurs fétiches, tambours et danses. Les symboles ostentatoires d'africanité étaient proscrits, avec plus ou moins d'insistance selon la période.
À
Santiago, les principaux jours de sortie étaient la veille de
Noël, le Jour des Rois et le 26 juin (fête de Santiago Apostól,
patron de la ville). À l'époque coloniale et dans les premières
années de la république, on nommait ces fêtes populaires de
carnaval mamarrachos. Le Jour des Rois[42],
étaient reçus au palais du gouverneur tous les cabildos
noirs de la ville. On honorait ce jour-là le Roi Melchior, leur
représentant symbolique désigné pour l'année à venir[43].
Ces festivités du 6 janvier furent suspendues à partir de
1886.
En 1681, le gouverneur Fernandez
de Cordoba interdit aux Noirs de se réunir dans les maisons
"pour les activités de danse et de cabildos",
l'autorisant seulement dans les rues, jusqu'à la cloche de
l'angélus.
Une rupture s'établit entre les cabildos
de La Havane et ceux du reste de l'île à la charnière du
XVIIIe s. En 1792, une série de lois (ban
gobierno) restreignent les activités des cabildos
et les obligent à trouver refuge hors des murailles de la ville[44].
Ceux-ci seront éloignés des églises, en dehors des centres
urbains et ségréguées[45].
La situation des cabildos n'était pas similaire à
Matanzas malgré certaines tentatives de durcissements.
À Santiago, la situation reste
identique jusque vers 1850, avec un rattachement des cabildos
aux églises et l'autorisation de s'établir en
centre-ville.
À La Havane s'établit une
démarcation très précise entre les cabildos de nation et
les confréries d'hommes de couleur[46],
pour mieux contrôler la population noire. Ces confréries étaient
placées sous la protection d'un saint catholique et liées avec
une paroisse. Leur raison sociale était l'entraide, le secours
mutuel. Pour les colons espagnols, elles présentaient un
cadre accessible et familier. Ils connaissaient ces
systèmes associatifs et ces structures organisationnelles depuis
des siècles et les avaient exportées vers presque tous leurs
domaines dans les Amériques.
Dans la Caraïbe de manière
générale, les cofradías ont contribuées au processus de
christianisation des populations africaines esclavagées et à
leurs relations avec l'Église. Le cas de Cuba n'a pas été
différent, ces structures ont reproduit celles qui existaient
déjà dans la péninsule ibérique dès le milieu du XVes.
L'Église avait des intérêts particuliers dans les Amériques et
l'évangélisation, tant des Indiens que des Africains depuis
l'implantation de l'esclavage, a joué un rôle central dans ses
projets. Cela a rendu possible l'expansion et l'exportation du
modèle des confréries, comme un moyen efficace et éprouvé
d'évangéliser et d'enseigner la doctrine chrétienne.
Hormis les mêmes valeurs d'entraide déployées dans les confréries, les cabildos auront également pour vocation de faire vivre le patrimoine culturel et cultuel des groupes ethniques qu'ils représentent. Leurs signes d'africanité et leur propension d'émancipation sociale seront les principales raisons de la tendance coercitive du pouvoir colonial à leur égard. Les processions annuelles du foyer du cabildo jusqu'à l'église étaient parfois dispersées par la police et les artefacts africains détruits ou confisqués.


Conversation
dans la rue Luis Patricio Landaluze, 1889, musée des
Beaux-Arts, La Havane
Les cabildos eurent avec les autorités coloniales des
rapports ambivalent, parfois instrumentalisés. À La Havane, de
nombreux cadres des cabildos étaient au service de
l'armée au sein des Batallones de Pardos y Morenos[48].
Il s'agissait d'une milice qui
joua un rôle capital aux côtés de l'armée dans la défense des
intérêts de l'Empire espagnol : défense du territoire
cubain contre la piraterie, soutien militaire lors de la guerre
contre la France en 1809, participation à la chasse aux esclaves
fugitifs.
Au XIXe s., les cabildos
organisaient une procession le jour de la fête de leur saint
patron. De manière générale, toutes les manifestations publiques
des cabildos avaient lieu en fonction du calendrier de
l'avent (Jour des Rois, Semaine Sainte...)
et en accord avec l'épiscopat.
Dans les défilés de mamarrachos[49] et même plus tard sous la République, les symboles ostentatoires d'africanité étaient proscrits, avec plus ou moins de rigueur selon les périodes. Ces manifestations agissaient sur la population noire et créole comme une soupape de décompression. Cela s'inspirait du "Jour des Fous" du Moyen-âge où les puissants laissaient s'exprimer les critiques envers l'autorité pour acheter la paix sociale.
À Cuba, les défilés du Jour des Rois sont suspendus en 1886. Au XXe siècle suivront une série de restrictions et d'interdictions, dont en 1917 l'annulation des carnavals, jusqu'à leur retour vingt ans plus tard.
Fiesta de ñañigos, Miguel Puente,1878, Musée des Beaux Arts, La Havane
Dès le XVIIe s., les
Noirs libres sont suffisamment nombreux pour que l'on puisse les
considérer comme véritable strate sociale intermédiaire, entre
les colons et les esclaves. L'appellation « Noir libre » ne
laisse en rien présager de leur couleur de peau, seulement de
l'émancipation par rapport au statut d'esclave. La société
coloniale cubaine vivait sous l'emprise du préjugé de couleur.
L'interdiction du mariage interracial est régie par une cédule royale en 1803, elle durera jusqu'en 1881[50]. Malgré les quelques prescriptions dans les ordonnances des gouverneurs successifs de Cuba, on ne peut pas véritablement parler de véritable code à l'égard des libertos. Ils furent néanmoins victimes de nombreuses déprédations, surtout pour ceux qui commençaient à prospérer financièrement. Les exactions des chasseurs d'esclaves[51] à leur égard deviennent si scandaleuses que Felipe IV édite une cédule royale en 1623 pour qu'elles cessent[52].

Scène de ville, Cuba colonial
La séparation des blancs et gens de couleurs intervient aussi
dans les activités sociétales
et de loisir. Walter Goodman, peintre anglais qui séjourna à
Santiago décrit une tombola de charité qui se déroulait sur la
place d'armes en 1864. Les gens de couleur ne pouvaient y
assister, se servant d'intermédiaires pour acheter des billets
et y participer[53].
La petite bourgeoisie de couleur
au XVIIIe s. imite les colons, n'hésitant pas parfois
à être elle aussi esclavagiste. A Santiago, entre 1780 et 1803,
54% des Noirs libres étaient propriétaires d'esclaves[54].
Pour la majorité, ils en possèdent moins de cinq. Il y aura
quelques exceptions, comme Elena Carrión qui en possédait douze,
répartis entre ses affaires en ville et ses terres à San Luís.
Certains Noirs libres possèdent
également des biens immobiliers, des exploitations agricoles, ou
des élevages de chevaux. En milieu urbain, ils sont artisans ou
petits commerçants, travaillent comme gens de maison chez les
Blancs. Ces exemples dénotent de la multiplicité des
conditions de vie et de statut social pour un Noir libre.

Cour intérieure à Santiago de Cuba, Joaquín Cuadras Blez, circa 1868, Musée des Beaux Arts, La Havane
La création et l'augmentation des cabildos peut
s'expliquer en réaction des hommes noirs et mulâtres et ce quel
que soit leur statut social, face aux ségrégations dont ils
faisaient l'objet. Les uns, libertos se protégeant et
secourant mutuellement au sein de ces sociétés, les autres
esclaves s'en approchant et les intégrant avec l'espoir de
meilleures conditions de vie, ou de se faire racheter leur
liberté.
 Iremé © Nicola Lo Calzo, années 2010, Regla, AF éditions |
 Un
plante abakuá, années 2010 © Daniel
Chatelain
|
Les sociétés abakuá sont les seules ayant été transplantées à Cuba suivant le modèle des sociétés à masques ekpe africaines. Ces sociétés masculines au sein des ethnies ejagham[55], ibibio et igbo de la pointe orientale du Nigéria, pratiquaient un culte autour des ancêtres et de la divination, réputé parfois violent et sanguinaire[56]. Réunis en guildes, ils faisaient du négoce, en particulier sur le commerce d'esclaves, avec les marchands européens de Calabar City. Les membre des sociétés secrètes abakuá sont originaires de ces ethnies, de même que les membres de certains cabildos carabalí.
En 1836 est
créée la première confrérie abakuá à Regla, dans la baie
havanaise. Il y en aura 79 à La Havane et 33 dans la région de
Matanzas pour tout le XIXe siècle[57].
Les sociétés abakuá étaient des foyers de marronnage et
d'africanité revendicative, principale raison de leur
illégalité. La solidarité unissant les initiés abakuá
passait au-dessus des lois coloniales[58].
On ne trouva pas pendant longtemps chez eux de processus de
syncrétisme religieux avec le catholicisme. Cependant, sous les
menaces et la répression gouvernementale, le dignitaire abakuá
Andrés Petit affirmera avoir rencontré le pape pour lui demander
l'autorisation d'utiliser des symboles chrétiens dans sa
confrérie. Il acceptera même les Blancs au sein de celle-ci, à
partir de 1886. Ce que certains considérèrent comme une trahison
fût peut-être une manière d'acheter un espace de liberté.
La répression à
leur égard continua malgré cela : jusqu'en 1897, des centaines
d'abakuá furent déportés dans des colonies espagnoles.
Seront confisqués leurs artefacts et instruments de musique.
Certains sont
visibles depuis au musée d'anthropologie de Madrid.

Itones,
bâtons de pouvoir abakuá, Musée d'anthropologie de Madrid © D.Mirabeau
Tambours abakuá, Musée d'anthropologie de Madrid © D.Mirabeau |
Erikundí,
Musée d'anthropologie de Madrid © D.Mirabeau
|
En parallèle
des sociétés abakuá, nous trouvons la présence de cabildos
bríkamo à Cuba. Comme pour les abakuá, ils sont issus des
ethnies ekoi de la pointe orientale du Nigéria. La
fréquentation de ces cabildos à l’époque coloniale n’était pas
limitative aux hommes, comme le sont les sociétés abakuá. Il
est notable que les femmes seront majoritairement à la tête
des cabildos bríkamo. Les seules zones où ils sont référencés
sont La Havane et Matanzas. Celui de La Havane, le brikamo San
José disparaîtra en 1887, ne souhaitant pas se soumettre à la
nouvelle loi transformant les cabildos en associations (cf.
chap.11). Le cabildo brikamo suama de Matanzas perdurera sous
le patronage de l’Enfant Jesus. Ce cabildo aura une importance
capitale dans la dissémination de la culture suama en
particulier en direction de la partie orientale de l’île et
Santiago de Cuba (cf. chap.13.2). Il connaîtra une période
d’interruption dans les années 1950, avec le décès de Yeya
Calle, sa doyenne. En 1974 rennaissent les fêtes du brikamo,
qui se range alors sous la protection d’un saint patron plus
créolisant, el Niño de Cañamaso.
Le premier cabildo de nation d'Oriente aurait été créé à Santiago
de Cuba en 1616. Il comportait 29 membres d'ethnie congo.
Le roi qui le gouvernait sera nommé Melchior[59]
et le patronage catholique était San Benito del Palermo[60].
Tous leurs membres étaient 'formellement" baptisés, savaient
lire et écrire le castillan[61].
D'autres cabildo sont enregistrés au fur et à mesure que
des groupes d'esclaves sont affranchis et toujours en respectant
l'uniformité ethnique. Les autorités leur concèdent des espaces
pour se réunir, en fonction de leurs moyens financiers[62].
Selon Olga Portuondo Zúñiga, la province de Santiago, comptait
au début du XIXe s. 10 cabildo de nation[63]
dont : 3 congo (brucamo, tiberé, cacanda), 3 carabalí
(osese, elugo, viví), 1 canga (sous le patronage
de Nuestra Señora de Loreto), 1 mina (l'autorisation de
celui-ci fût refusée), 1 mandinga, 1 de tumba francesa
(El Tivolí, sous le patronage de Nuestra Señora de Belén)[64].
Cette registration de l'archevêché de Santiago ne répond pas à
la classification actuelle déterminant précisément l'origine de
chaque ethnie. Si l'on se réfère aux classifications
contemporaines d'Ortiz ou de Guanche : le cabildo cacanda
serait à comprendre lucumí, le brucamo serait
carabalí; le canga serait ganga dans
une autre graphie.
A Camagüey, il est dit que les esclaves congo, carabalí
et mandinga étaient prédominants en ville. Il existait avant la loi de 1880, quatre cabildos,
tous situés dans des quartiers périphériques de la ville.
Les congos, par une présence plus massive dans la population
noire auront deux cabildos. De leur réputation de
domesticité, ils bénéficieront de plus de prérogatives tant de
l'église que du pouvoir colonial. Le cabildo congo de
Santa Bárbara était le plus important. Le cabildo
congo luango était constitué pour la plupart d'anciens
serviteurs de riches réactionnaires de l'île. Les luango
étaient connus pour le panache de leurs costumes. Il était
courant lors des jours de fêtes du chapitre, que la reine soit
accompagnée par des accords de la marche royale, quand elle se
dirigeait vers le trône.
Le cabildo mandinga était sous le patronage de la Virgen
de la Candelaria. Les mandingues étaient réputés très
orgueilleux, de ceux qui s'étaient le plus suicidés pour
échapper à l'esclavage, de sorte qu'il y avait plus de femmes
que d'hommes dans le cabildo. Le chant des mandingues
était accompagné de tambours, güiros et d'un marimba.
Le premier cabildo carabalí sera autorisé par l'évêque
Santiago Echevarria en 1776, une sous le patronage de la Santíssima
Trinidad. C'était visiblement une fraternité religieuse,
avec des visées officielles d'évangélisation.
A partir de 1803, se créent de nouveaux cabildos de
nation. Les troubles de la révolution sur l'île de
Saint-Domingue et l'abolition de l'esclavage dans la jeune
République d'Haïti entraînent un arrivage conjoint de rescapés
Blancs, Métis et Noirs, esclaves ou libres,
en particulier vers la partie orientale de Cuba. Les colons
français exilés rachètent des terres et s'installent à Cuba avec
leurs esclaves domestiques, à dominante dahoméenne. Ils achètent
sur place de nouveaux « nègres de jardin » ou esclaves
de production, en majorité des congos. La prospérité de
leurs plantations, principalement du café, sera instable, puis
connaîtra un effondrement pendant la guerre d'indépendance. Mais
entretemps, une tradition culturelle spécifique syncrétisant
divers héritages s'est créée chez les « Noirs français » des
plantations.
Avec l'indépendance et la fin de l'esclavage ils rejoignent les villes de
Santiago et Guantánamo (créée grâce à ces plantations). Ce
seront des Noirs libres (souvent fils adultérins de maîtres) et
seront artisans ou commerçants. Ils seront à l'origine de la
création des cabildos de tumba francesa[65]
axés sur l'entr'aide, la convivialité et les danses de salons,
mais aussi adaptant à la ville les défilés de tahona (qui
furent d'abord rurales), en distinguant bien les deux activités.
Ces cabildos deviendront sosyété avec la loi sur
les associations[66].
A la fin du 19e s., se dernier
prend le nom de Cabildo de la Santíssima Trinidad. Le dimanche
de Pentecôte, ses membres assistaient à la messe dans la grande
cathédrale, la reine portant le symbole du cabildo, une
colombe posée sur un globe doré. Ils dansaient le rigodon et le
quadrille une fois avoir regagné leur foyer. Ce cabildo
était apprécié par les habitants de Camagüey pour la qualité de
ses prestations musicales. On y jouait des maracas, une flûte
rudimentaire, des tambours dont l'un en bambou, de presque un
mètre de hauteur.
A Guantanamo, hormis quelques références dans les registres
paroissiaux, peu de traces des cabildos en général.
Marta Esquenazi en liste deux dans cette province, l'un à Songo
l'autre à Manuel Tames[69].
Les recherches sont rendues difficiles depuis l'incendie du
bâtiment des archives municipales de Guantanamo dans les années
1930.
José Sanchez, historien de la ville cite une Comparsa Carabalí del
Tiguabito dès 1844[70].
On parle d'un cabildo carabalí dans la presse locale en
1865. Ce dernier défilait dans les mamarrachos, les
carnavals de l'époque coloniale. Reinaldo Videau, respectable
doyen de la carabalí de Guantanamo[71]
disait en 2015 ne pas avoir connaissance qu'il y ait eu un
cabildo de nation carabalí à proprement parler
en ville. Néanmoins, de nombreux habitants de la région avaient
goût à se rassembler pour danser et jouer ces traditions. [72]
Pour Santiago de Cuba, on trouve trace d'une communauté carabalí
déclarée en 1783 par Marcos Caballero, son fondateur. Elle sera
enregistrée comme Cofradia de los Negros Carabalí. Elle
était composée des nations ibibio (zone côtière du
Calabar) dont les elugo et les viví, mais aussi
des suama de la nation igbo (plus au Nord dans les
terres).
Echapper à la dénomination cabildo fut le moyen que trouva le
fondateur de la carabalí, pour éviter un procès avec
Francisco Verdecia, roi du cabildo congo. Ce dernier se
considérait d'une caste supérieure à qui les carabalí
auraient dû allégeance. Verdecia possédait un rôle charismatique
sur tous les esclaves, les congo étant
étaient encore majoritaires à l'époque en
Oriente parmi les populations noires[73].
De plus, il était le seul responsable de cabildo à
entretenir des relations régulières avec les autorités.
La composition multiethnique de la Cofradia de los Negros Carabalí
rejoint le principe de ce qui fût pratiqué au début XIXes.
à Camagüey, avec des problèmes de luttes intestines similaires.
Marcos Caballero règnera sur la Cofradia de los Negros
Carabali pendant plus de trente ans, puis au travers de
ses successeurs qu'il s'arrange à faire nommer, exclusivement
d'origine elugo. Cette hégémonie des elugo
motive les membres des nations viví puis plus tard les
osese et les isuama à quitter la Cofradia
pour créer leur propre cabildo.

Roi de la Carabalí Isuama © Nicola Lo Calzo, années 2010, Regla, AF éditions
La Carabali Viví sera
fondée en 1797, par Ramon Garvey, Nicola Rigores, Antonio Mozo
et José Ramon Granda Garcia. Son foyer se trouvait dans l'actuel
quartier de Los Hoyos. Il est stipulé sur son règlement officiel
l'obligation pour ses membres d'être des Noirs libres. La
majorité travaillaient dans le monde
agricole comme ouvriers, métayers, petits propriétaires
terriens, cultivant le tabac aux alentours de Santiago. Le cabildo
sera rebaptisé Club San Salvador de Horta à l'indépendance de
Cuba et survivra jusqu'en 1909, où il sera dissous.
Les membres de l'ethnie osese de la Cofradia de los
Negros Carabali s'autonomisent également dans la
première moitié du XIXes., en créant le Cabildo Osese,
sous le patronage de Nuestra Señora de Santa Barbara. Nous
supposons qu'il dura jusqu'à l'orée du siècle car nous ne trouvons
plus sa trace dans les documents officiels ni la presse après
cette période. Il est également possible qu'il ait perduré
quelques temps sous un nouveau nom.
Les membres de l'ethnie isuama s'autonomisent en 1824, marquant ainsi la fin de l'hégémonie de Caballero et de ses successeurs sur les carabalí de Santiago[74].

Yeya,
doyenne de la Carabali Izuama (99 ans à l'époque de la photo),
qui a dû connaître l'esclavage.Circa 1952 © Panchito Cano,
coll. Vicki Gold Levi.
Au milieu du XIXe s. commence le déclin des cabildos,
le marronage et les mouvements d'émancipation des esclaves
gagnent du terrain. En effet, la proximité avec la jeune
république d'hommes libres d'Haïti et la Jamaïque, qui abolira
l'esclavage en 1836, amènent de nouvelles populations à Cuba,
principalement dans sa partie orientale. L'ensemble de la
société coloniale est sollicité dans l'effort de guerre contre
les marrons. Dans la région orientale, à partir de 1815, après
l'échec cuisant de l'armée sur le palenque d'El Frijol,
les contributions financières affluent en réponse, venant de
toutes les personnes libres, des notables aux petites gens[75].
Au regard de cette situation et à l'orée de l'abolition
définitive de l'esclavage à Cuba[76],
la réglementation et le contrôle des cabildos de
durcissent.
Les artefacts africains sont parfois saisis et détruits. Les plus révoltés et perturbateurs contre le pouvoir colonial sont emprisonnés puis déportés. Ces déportations politiques des Noirs émancipés ont été monnaie courante de 1862 à 1897. Ils furent envoyés dans des colonies pénitentiaires espagnoles : Fernando Poo (île en face du delta de la Cross River, au Nigéria), Chafarinas (îles proches du Maroc, vers la frontière avec l'Algérie) et Ceuta (en face de Gibraltar en Méditerranée). Le groupe le plus touché par ces déportations fût les abakuá. Ils seront environ 600 à faire le voyage transatlantique. Il y eut un certais cynisme du gouvernement espagnol à les envoyant essentiellement à Fernando Poo, l'île se trouvant face à la terre de leurs ancêtres, le Calabar.
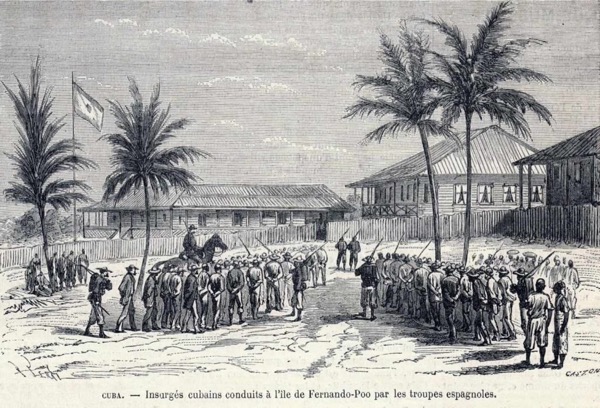
Insurgés cubains conduits sur l'île de Fernando Poo, 1869, Gaston, Le Monde Illustré
En 1883, les autorités de La Havane exigent que la licence
des cabildos soit réexaminée chaque année, que soit
observée la séparation entre Africains de naissance et Créoles,
et que leurs activités tendent vers des caractères récréatifs.
En 1884, les défilés des cabildos sont interdits, puis
toutes leurs activités, sauf s'ils se soumettent à la nouvelle
législation des sociétés de gens de couleur à caractère culturel
et d'entraide. Les cabildos doivent adopter le patronage
d'un saint catholique et sont rattachés à une paroisse. Leurs
biens deviennent alors propriété du clergé en cas de dissolution
du cabildo.
En 1887 est promulguée la loi sur les associations. Sont alors déclarés officiels à Santiago de Cuba en 1888, le Club Juan Gongora (partie de l'ancien cabildo congo), la Sociedad el Tibere (autre partie de l'ancien cabildo congo), le Cabildo Santa Barbara[77] (ancien cabildo carabalí osese), le Club San Salvador de Horta (ancien cabildo carabalí vivi), la Sociedad Nuestra Señora del Carmen (ancien cabildo carabalí elugo) et la Sociedad Carabali Izuama (ancien cabildo Isuama), le Cabildo Cocoyé (société de tumba francesa du Tivolí, regroupant des congos et des créoles).

Ñañigos
en fiesta,
Luis Patricio Landaluze, circa 1880, musée des Beaux-Arts,
La Havane
Jusqu'au XXe s., l'ethnocentrisme domine la pensée occidentale et justifiera des siècles de traite négrière. Considérer les hommes Noirs et Créoles comme inférieurs, à peine humains, a servi les intérêts économiques du vieux continent et de la colonisation par les Amériques.
Le Noir se devait, dans le meilleur des cas, être éduqué, élevé vers des principes moraux, dans la lumière du christianisme. Les pratiques animistes étaient considérées comme relevant de la sorcellerie ou signe d'attardement civilisationnel. De nos jours, et malgré le métissage, les cérémonies et cultes afro-cubains souffrent encore de cette imagerie de malfaisance barbare dans l'inconscient collectif.

Un acte abolitionniste pour lever des fonds et libérer des esclaves à Madrid, 1868, auteur inconnu
En 1888, avec l'abolition de l'esclavage, les cabildos
disparaissent en faveur des sociétés de gens de couleurs,
revêtant un "caractère récréatif et de secours mutuel"[78].
Les nañigos[79]et
autres
éléments séditieux en sont exclus. A la différence des anciens
cabildos, les sociétés acceptent la mixité ethnique, mais
gardent une continuité culturelle en n'exécutant que les
traditions propres à l'ethnie de l'ancien cabildo[80].
Les pratiques religieuses subsistent en secret dans les
sociétés, malgré la défaveur des autorités[81].
Dès 1880 avec la nouvelle loi sur les associations, la plupart des cabildos
ne se sont pas reconnus par les autorités. Ils maintiendront
illégalement leur organisation à partir des réseaux familiaux et
parentaux, formant ainsi des casas-templos et cofradias
où sont pratiqués divers cultes d'origine africaine ou
caribéenne (santería, palo, abakuá, arará, vodou,
spiritisme). Ces initiatives privées donneront lieu à des
persécutions du gouvernement jusqu'à la nouvelle constitution de
1940, autorisant la liberté de culte.
Avec la révolution de 1959, le nouveau régime appelle à en finir avec les discriminations raciales et religieuses, prônant l'unité du peuple dans le marxisme. Cela ne se fait pas sans difficultés ni paradoxes idéologiques. Le catholicisme en particulier, car pratiqué par le plus grand nombre, est considéré comme un frein à l'évolution vers le socialisme. Ainsi les religions chrétiennes seront séparées du domaine culturel afro-cubain considéré comme superstitieux et archaïques. Ceci n'empêchera pas le développement des formations folkloriques afro-cubaines sur toute l'île[82], les tournées des groupes à l'étranger et leur participation aux carnavals. Vers la fin des années '80, la lutte idéologique contre les religions s'estompe, l'industrie touristique contribuant indirectement à l'essor des cultures africaines.
En 1992, la liberté de culte est inscrite à la constitution et l'Etat
déclaré laïc. L'église catholique du fait de son organisation
internationale et son implantation locale continue à jouer un
rôle de contre-pouvoir ou de médiation, en particulier dans les
affaires de libération de prisonniers politiques[83].
Le premier cabildo carabalí dénommé Elugo ou Olugo date
de 1783, c'était l'appellation non-officielle de la Cofradia
de los Negros Carabalí fondé par Marcos Caballero. En
1877, on relate une sortie de la Comparsa Carabali Olugo, pour
commémorer le neuvième anniversaire du « Grito de
Yara »[84].
Le fait que certains héros de l'armée de libération (le général
Antonio Maceo Grajales et le brigadier Flor Crombet) furent très
proches du cabildo Olugo n'y est pas étranger.
Les registres de l'évêché de Santiago témoignent de l'existence du cabildo carabalí Elugo en 1889 dans le quartier français du Tivolí. Il fut enregistré comme congrégation catholique sous le patronage de Nuestra Señora del Carmén. La même année, ils se déplacent jusqu'au campement des mambis (armée de libération), dans le lieu-dit El tablón, proche de San Luis. Les activités musicales et de danse du cabildo feront partie des distractions du campement, quand les soldats ne seront pas au combat.

Défilé des enfants de la Carabalí Olugo, carnaval de Santiago © Kristina Wirtz
On trouve des traces écrites de la participation de la comparsa[85]
Olugo aux défilés de carnaval dès 1880, sous le nom de Comparsa
de los Negros Carabalí. Après
la loi sur les associations, elle défile en 1894 sous le nom de
Carabalí Oluggo. Cette Carabalí Olug(g)o
participe cette année-là parallèlement à la comparsa de
la Carabalí Izuama.
Ces comparsas sont composées de danseurs, musiciens et portes drapeaux et défilent lors de de diverses fêtes catholiques, nationales ou municipales. Ces deux carabalí répondront à l'appel des mouvements révolutionnaires contre les Espagnols et connaîtront les affres de la répression.
En 1902, le maire de Santiago supprime les défilés des comparsas carabalí pendant le carnaval, celles-ci "évoquant le triste passé de l'esclavage". La Olugo brave l'interdit et effectue un court défilé, avec des bannières représentant des noirs crépus en guise de protestation[86].

Roi & reine Olugo © Nicola Lo Calzo, années 2010, Regla, AF éditions
Le premier document municipal date une naissance officielle de
l'association cabildo en 1913, sous le nom de Olugo ou
Orugo. Cet ethnonyme fait référence à un dialecte africain du
Calabar. La raison sociale du cabildo est une « société
d'entraide et de secours mutuel ». Malgré l'origine ethnique carabalí
de la Olugo, on trouve dans son foyer une représentation
d'Eleguá, esprit protecteur africain d'origine yoruba. Ce
symbole récent témoigne d'une revendication de l'africanité au
travers du culte yoruba, standard cultuel le plus répandu à Cuba
de nos jours[87].
En 1919, le président Mario García Menocal obtient le soutien militaire
des Etats-Unis pour protéger les intérêts des centrales
sucrières américaines, victimes de mouvements sociaux sur le
territoire. Lors du carnaval, la carabalí Olugo va
entonner un chant contre l'interventionnisme américain[88].
Elle sera à la suite de cela interdite et condamnée à une
activité clandestine.
Nous retrouvons la trace en 1939 d'une nouvelle participation de
la Olugo au carnaval, mais face à l'absence de soutien, voire
des mesures répressives, le cabildo est dissout en 1940.
Il faudra attendre 1961 pour qu'il renaisse, avec 31 membres, puis
l'année suivante pour assister à son défilé lors du carnaval. En
1962, le conseil municipal de culture de Santiago lui octroie
une récompense, le considérant comme l'un des groupes
traditionnels qui comptent pour le carnaval, au même titre que
la Isuama, ou la tahona de la société de tumba
francesa.
En 1981, après le ravage de son foyer par un ouragan, la Carabalí Olugo
se déplace du Tivolí au quartier de Veguita del Galo où elle se
trouve toujours.

Comparsa caranbalí Olugo, carnaval de Santiago de Cuba, années 90
Comme nous l'avons vu précédemment, des membres de l'ethnie isuama de la Cofradia de los Negros Carabalí s'émancipent et créent leur propre cabildo en 1824[89]. Les isuama sont un sous-groupe de l'ethnie igbo, au Nord-Ouest de la Cross River au Nigéria.Le peu de sources disponibles ne nous permet pas d'affirmer une continuité ni une filiation directe avec la Comparsa Carabalí Isuama dont nous parlerons plus loin.
Un témoignage cite l'existence du Carabalí Izuana, ou Carabalí zona de
Santa Lucia, très populaire auprès des santiagueros dans les
années 1884-87. Il était question d'un groupe de défilé remarqué
pour ses tenues vestimentaires et le nombre de ses participants[90].
Santa Lucia était le nom de la paroisse auquel il était rattaché
et où résidait la patronne du cabildo.
Le premier document officiel en mairie de Santiago date la
naissance de la Comparsa Cabildo Isuama en 1894, continuant à
utiliser par tradition le terme cabildo[91].
La presse de l'époque fait état de sa première sortie pour la
fête de San Juan, le 24 juin 1894. Manuel Palacios Estrada vante
la sortie d'un cortège d'au moins 700 personnes lors du carnaval[92].
Cela paraît exagéré, ce comptage approximatif comprenait les
adhérents de la Isuama et la foule des sympathisants qui
s'étaient insérée à la comparsa. Cette forte popularité
nous donne un indice sur l'antériorité du cabildo. Il parait peu
vraisemblable qu'il ait remporté autant de succès dès sa
première année d'existence.

Reine et membres de la Carabalí Isuama, carnaval de Santiago de Cuba, 1989 © Judith Bettelheim
Le Cabildo Isuama dans sa version officielle de 1894 fût fondée par les frères Nápoles, dits "Baracoa". L'origine de cette fratrie est obscure et les sources diffèrent. Leur berceau familial était visiblement à Matanzas, où la plupart des sept frères étaient investis dans les activités de sociétés secrètes abakuá, mais également dans le cabildo carabalí brícamo Suama. La famille déménagea dans un village proche de Baracoa, où elle y gagnera son surnom, puis à Santiago où ils fonderont le Cabildo Isuama en référence à celui de Matanzas. Les frères Nápoles exerceront en ville des métiers d'artisan (tailleur, cordonnier, cigarier, etc).Le cabildo sera sous les auspices de San Juan Nepomuceno[93],
dont l'autel se trouve dans l'église de San Francisco. La
célébration de ce saint catholique cachait celle d'un esprit carabalí
appelé Pa Bonú. Les détails sur ce culte aujourd'hui disparu se
sont perdus dans les méandres d'une pratique rendue secrète,
pour éviter la répression des autorités.
Le foyer de la Isuama prendra place dans le quartier de Los
Hoyos, où elle réside toujours, sur le bas de la rue Carniceria.
En 1894, le cabildo comptait essentiellement des
artisans et petits commerçants.

Mambis, guerre d'indépendance de Cuba
La Isuama va jouer un rôle important dans les mouvements
insurrectionnels contre les colons espagnols et dans les
préparatifs de la guerre d'indépendance. Le général
indépendantiste Guillermón Moncada était très lié avec les
frères Nápoles lequels s'engagèrent dans l'armée de libération.
Pendant la guerre de 10 ans, la carabalí profitait des
sorties de sa comparsa pour faire transiter des armes et
médicaments dans ses tambours. Certaines strophes narrant les
faits d'armes de cette époque résonnent encore aujourd'hui dans
les défilés des comparsas carabalí[94].
Certainement lié à ces mouvements insurrectionnels, mais aussi avec des mesures répressives contre les pratiques de cultes africains, des membres des cabildos carabalí furent déportés. Ce fût le cas pour Fernando Nápoles, l'un des fondateurs de la Isuama qui fût déporté sur l'île de Ceuta en Méditerranée. De sa condition de vie sur place des plus précaires, il contractera la tuberculose. Il sera rapatrié à Cuba où il finira sa vie quelques mois avant le déclenchement de la Guerre des Dix Ans (1868-78).

Déportés cubains à Figueras, 1867
Malgré
l'implication des Isuama et Olugo dans la libération de
Santiago, les élites blanches vont observer un certain rejet de
leurs activités jusque dans les années 1950. Il faut clairement
y voir là une forme de racisme. La situation des Noirs va se
détériorer dès la sortie des guerres d'indépendance. Le
« péril Noir », fantasme hérité de la révolution
haïtienne est encore présent dans les idées reçues des blancs,
ainsi que le traumatisme des guerres de marronage. Au tournant
des deux siècles, s'y ajoutera la naissance du Parti des
Indépendants de Couleurs. 3000 de ses membres seront massacrés
par l'armée en 1912.
Au lieu de fréquenter ces cabildo-comparsas, ou des sociétés aux
racines africaines marquées, les mulâtres les plus élevés
socialement et économiquement préfèreront rejoindre des
associations comme La Luz de Oriente ou le Casino Cuba[95].
Des membres de la Isuama joueront cependant un rôle politique dans la vie municipale de Santiago, même si la place des Noirs dans l'administration et la politique locale restera très minoritaire jusque dans les années 30.

Danseuse au foyer de la Isuama © Irene Cruz Gilbert, années 2010
Les fonctions cultuelles des cabildos s'estompent avec les années et sont abolies définitivement en 1960, où ils sont convertis par le Conseil National de Culture en groupes folkloriques. Dans quelques cas exceptionnels, la carabalí jouera encore un rôle cultuel. Adrian H. Hearn témoigne en 2008 d'avoir assisté aux obsèques d'une dignitaire de la Carabalí Isuama. La défunte étant fille d'Oyá (déesse des cimetières dans la santería), les tambours rythmeront la messe dans l'église puis le cortège jusqu'au cimetière de Sainte Iphigénie. Nous retrouvons des manifestations du même type lors de funérailles nationales et religieuses pour des grandes figures de la culture cubaine (Lázaro Ros à la fin des années 90, Merceditas Valdés).

Comparsa Isuama au carnaval de Santiago de Cuba © Irene Cruz Gilbert, années 2010
mp3
: percussions
de la carabami Isuama (extrait)
L'analyse des règlements officiels des carnavals et la presse locale au XIXe et XXes. montre les difficultés d'exister pour toutes les comparsas noires[96]. Des interdictions à défiler aux mesures restrictives, ou à leur autorisation sans véritable soutien des élites, tout ceci n'a pas favorisé le développement des comparsas caranbalí.
A Santiago de Cuba, en 1909 et 1911, la presse se fait écho d'un Carabalí de la Plaza de Marte, participant au carnaval, en plus des Olugo et Isuama habituelles. En 1919, le quartier de Los Hoyos présente deux comparsas carabalí lors du carnaval, la Isuama et la Bata Amarilla. Cette dernière connût une courte existence.
Comme pour les comparsas de conga ou les sosyétés de tumba francesa, la concurrence était mieux venue d'un quartier à l'autre. Dans les années 1930, sortait en plus de la Isuama, la carabalí de Victoriana Vitué du quartier de Mejiquito[97].
Au carnaval de Santiago de 1938 vont défiler la Carabalí Macumba del Edén et la Carabalí de la Reina Salomé. Cependant, dès les années 1940, seule la Carabalí Izuama apparait sur les comptes-rendus de carnavals, au point d'être identifiée populairement comme LA Carabalí.
Dans les années '30 et '40,
beaucoup d'entreprises retirèrent leur soutien financier aux comparsas.
La situation économique du pays laissait peu de place au
développement de nouveaux groupes de défilé. Seuls quelques
grands sponsors tel que les alcools Bacardí ou les cigares Edén
apportaient encore leur soutien. D'autres part, la
discrimination sociétale et les luttes intestines n'ont pas
permis aux nouvelles comparsas carabalí de se
pérenniser.
Les seules comparsas carabalí qui subsistent actuellement sur l'île sont la Isuama et la Olugo à Santiago, ainsi que la Carabalí de Guantanamo.

Défilé de la Comparsa Carabali de Guantanamo, années 2020 © Miguel Angel García Velasco
Une fête de défilé débutait par la moyugbación, un salut
aux fondateurs de la carabalí. Les noms et grades de
chacun d'entre eux étaient déclamés, accompagnés par le
bruissement des chachas (hochets en osier) et le trémolo
des tambours.
Il continuait avec le rythme et la chorégraphie de la obbia,
dont les chants rendent hommage aux dignitaires et aux ancêtres.
Cette séquence fût religieuse, comme tout ce qui touche aux
défunts. Il est intéressant de noter en ce sens la similitude
avec la obia ou obeah pratiquée dans les îles
caribéennes anglophones[98].
Selon les témoignages que j'ai pu recueillir, la obbia de
carabali est maintenant exécutée lors de la rencontre de comparsas
carabalí et manifeste plutôt une volonté de défi mutuel,
en effectuant la meilleure prestation possible. Cet aspect
guerrier de la obbia rejoint celui du culte obeah
des communautés cimarón du Surinam[99]
.

Défilé de la Isuama, carnaval de Santiago de Cuba, © Irene
Cruz Gilbert, années 2010
Après l'exécution de la obbia, commence le cortège, au
son du paso de calle ou paso de camino, à la
vélocité modérée. Toute trace d'africanité dans la chorégraphie a
disparue ; encore un témoignage criant sur l'asservissement et la
machine à oublier, lourd tribut d'une époque coloniale pas si
lointaine. La chorégraphie du paso de calle est gracieuse
et mesurée, à la manière des danses de cour européennes du 18e
s.
Lorsque le cortège s'arrêtait, il pouvait arriver que soit
exécutée une contredanse, ou un quadrille à la française. Les
danseurs en couple se doivent d'un port altier, les avant-bras
suspendus et surtout se tenir à distance l'un de l'autre.
Une autre séquence, tombée en désuétude était le concours du rapto
de la reina.
Après décision du jury, la formation s'étant le mieux mise en
valeur, avait l'autorisation d'emmener plusieurs jours durant la
reine la carabalí adverse dans son foyer. Elle participait alors
aux activités domestiques du cabildo jusqu'à la fin des festivités
du carnaval. Nous retrouvons la même coutume dans la tahona
et sa partie hechacorral (litt. "faire
courrir"). Cette séquestration devait être d'ordre symbolique ;
nous imaginons difficilement une reine, femme de tête, accepter
docilement cette soumission.

La Isuama au théâtre Martí, Santiago de Cuba, © Irene Cruz Gilbert, années 2020
A la fin du défilé, une moyugbación
similaire à celle de préambule était alors déclamée, ainsi
qu'une obbia finale[100].
Dans les défilés contemporains des Isuama et Olugo, seules les
séquences de la obbia et du paso de camino sont
encore exécutées. La Carabalí de Guantanamo ne joue plus pour sa
part que le paso de camino.
Les cortèges des comparsas carabalí arborent
des tenues aux couleurs unies et soutenues, comme la plupart des
troupes de carnaval. Il faut que le groupe puisse être identifié
de loin et fasse de l'effet. Les couleurs criardes ne laissent
présager en rien du raffinement du costume. Dentelles, rubans et
broderies sont des éléments indispensables à l'habillage d'une
robe ou d'une jaquette.
 Danseuse de la comparsa infantile Isuama, © Irene Cruz Gilbert, années 2010 |
 Danseuse de la Carabali de Guantanamo, années 2020 © Miguel Angel García Velasco |
Les femmes portent des jupons et de longues robes larges et bouffantes à liserés colorés. Souvent leurs tenues sont bicolores, avec une base blanche ornée de soieries colorées. Elles rangent leurs cheveux sous des foulards savamment noués, portent des bijoux et leurs colliers de religion[101] de manière ostentatoire.

Danseuse Isuama © Judith Bettelheim, années 80
Les hommes sont vêtus de pantalons courts arrivant à la
cheville, des bas blancs et une chemise à jabot couverte d'une
jaquette brodée. Ils portent diverses formes de couvre-chefs, du
bicorne au bonnet de santería[102],
ou au chapeau de paille.
Le fantasme de la distinction des
cours européennes est à l'œuvre à travers ces tenues
vestimentaires, la retenue étant manifeste dans la manière
de se mouvoir et de danser.
Les porte-drapeaux arborent les
couleurs de la carabalí, ainsi que des slogans ou
maximes du moment.
Selon le grade de chacun à l'intérieur de l'organisation du cabildo, (vassal, consul, duc, roi) des accessoires les identifient : canne à pommeau, bicorne, épaulettes en passementeries, couronne. Le costume auquel on porte le plus de soin et de fastes est celui de la reine. Elle est vêtue d'une robe de tissu moiré ou constellé de perles et une couronne en verroterie. La reine était secondée dans les années 1940 et '50 par une princesse, rôle qui pouvait être tenu par un homme[103].
Bousculer l'ordre social et
politique est l'apanage des jours de carnaval. Le
travestissement, la transgression sexuelle dans les codes
vestimentaires et l'attitude corporelle était autorisé
dans ce cadre festif. Il n'empêche que cette tradition de
princesse travesti n'a pas duré, le
machisme de l'inconscient collectif cubain ayant repris le
dessus.
 Danseuse et porteuse de poupée, foyer de la Isuama, anées 90 © Daniel Chatelain |
 Danseuse et porteuse de poupée, foyer de la Olugo © Irene Cruz Gibert |
Nous ne trouvons plus de symboles religieux dans les défilés actuels de caranbalís, mais quelques marqueurs d'africanité. En effet, la reine porte toujours à la main une poupée représentant les ancêtres du cabildo, même type de poupée que nous retrouvons sur les autels dans les cultes afro-cubains[104]. Autre marqueur commun à d'autres comparsas est la symbolique des couleurs unies dans les costumes de défilé, désignant des orishas de la santeria ou leur saint catholique correspondant (Ochún et La Virgen del Cobre pour le jaune, Babalu Ayé et San Lázaro pour le violet, etc.). Les symboles carabalí d'origine se sont depuis longtemps effacés, au profit de ceux du culte lucumí, standard largement adopté sur toute l'île comme marqueur de culture africaine.

Carabalí Olugo - Défilé du Festival del Fuego, Santiago de Cuba © José Millet
La cloche
Joueur d'ekón, caranbalí Olugo © K. Wirtz
Cloche sans battant intérieur, frappée par une batte métallique.
Elle est de forme similaire à des cloches d'Afrique de l'Ouest,
ainsi que celle jouée dans les confréries abakuá. On la
nomme ekón ou muela, ou pico arado[
105]. La
cloche africaine utilisée d'origine, est remplacée
parfois par un soc de charrue, ou toute autre pièce métallique
aux mêmes propriétés. La cloche va battre la pulsation en
produisant deux sons, l'un grave et l'autre aigu. Elle donne
ainsi le cadre rythmique général auquel tous vont se référer.
A Guantanamo, la Carabalí utilise
une llanta[106],
comme dans les congas de carnaval.
Les cha-chas
Joueur de cha-cha, carabalí Olugo © K. Wirtz

Cha-cha, détail © K. Wirtz
Appelés également chanchaes ou marugas.
Hochets de forte dimension en
fibres végétales remplis de sonnailles. Sont
joués en paires, un hochet dans chaque main. On utilise les
fibres d'une liane grimpante commune, comme la bejuco de
cañasta ou bejuco de guanikí[107]
pour la confection du hochet. Ses fibres sont réputées pour
leur flexibilité et robustesse et utilisées en vannerie. On
remplira le hochet de pièces métalliques, comme des capsules de
bouteilles.
Hormis leur forte dimension, les
cha-chas sont très proches des erikundí utilisés
dans les confréries abakuá.
Deux joueurs de cha-chas
sont nécessaires à la polyrythmie au sein d'une comparsa
carabalí, chacun avec une paire de hochets.
La Carabalí de Guantanamo ne joue pas les cha-chas, mais
utilise un autre système de sonnailles : un gros cylindre
métallique rempli de graines et une paire de mini-haltères
remplies de sable.

Percussionnistes de la Carabali de Guantanamo, années 2020 © Miguel Angel García Velasco
Les tambours

Percussionnistes de la Carabali Izuama, auteur inconnu, années '70. Juan Medina Duany (sous-directeur) au centre, Hechevarria à la droite
Ce seront tous des bi-membranophones de taille différente, selon
le rôle qui leur est imparti à l'intérieur de la polyrythmie.
Elles sont frappées à l'aide d'une batte en bois d'une main,
l'autre servant à étouffer la peau opposée. Selon les comparsas,
seront présente de quatre à six grosses caisses. A Guantanamo,
seront jouée quatre parties différentes. Dans la Olugo et la
Isuama ce sont actuellement cinq parties.
Les voici ordonnées de la plus
aigüe à la plus grave :
- La repicadora :
ou repartidora.
Elle joue un rôle de soliste avec beaucoup de variations dans un
système de conversations avec la respondedora.
On l'appelle également quinto,
comme avec d'autres groupes où le tambour aigu
joue un rôle de soliste.
- La tambora:
petite grosse caisse, semblable à la tambora
ou bimba dans
la tumba francesa. On l'appelle également par sa fonction, fondo salidor. Elle exécute un rythme linéaire avec peu de
variation. Selon l'expression d'usage, elle remplit de bruit (llena
de ruido)
- La respondedora :
de registre medium. Le placement de ses « sons-clés »
crée un dialogue avec la repicadora.
En fonction des appels de cette dernière, le
joueur de respondedora exécute
des réponses, selon son inspiration.
- La tragualegua : littéralement
"transporter sur des lieues". Ce nom date de la
guerre d'indépendance. Grâce à sa forte dimension, on y cachait
alors des armes et médicaments. Une sortie de la comparsa
était un prétexte pour aller livrer des rebelles à l'extérieur
de la ville. De même que la pilonera, elle joue une base
sobre.
- La pilonera :
grosse caisse au diamètre imposant dont la caisse de résonance
est peu profonde. Elle joue une figure rythmique sur laquelle va
se poser le dialogue de deux autres grosses caisses au registre
plus aigu (repicadora
et respondedora).
-La quitapesares : le
tambour de taille la plus imposante. N'est plus utilisée.
Cette grosse caisse n'était jouée que pour des circonstances
exceptionnelles, lors d'une visite d'une carabalí concurrente,
ou pour concurrencer une conga de carnaval trop bruyante. On la
disait posséder des pouvoirs spéciaux.
Son caractère sacré la fait reposer accrochée au mur, de même
que les tambours batá de
fundamento dans la santería.
Cet usage est rituel en même temps que pratique, à fin
d'éloigner le tambour de l'impureté et de l'humidité du sol,
afin que ses peaux restent bien tendues.
mp3 :
polyrythmie de cabildo caranbalí

Percussionnistes de la Olugo © K. Wirtz
La flûte :
aérophone
en bambou à trois ou quatre trous. On la signale à Camagüey et à
Santiago dans la Isuama. Ce type de flûte fut également joué
dans certaines confréries abakuá, où elle prenait le nom
de biabanga[108].
Son usage a aujourd'hui disparu et aucune trace phonographique
n'en témoigne. Nous pouvons supposer qu'elle amenait des
éléments de contrepoint mélodique au chant, ainsi que des
interventions solistes. Au regard des possibilités réduites de
notes, elle ne pouvait pas jouer les mélodies chantées ensuite
par le chœur, comme le ferait la corneta china dans les
congas de carnaval. La faible puissance sonore de
l'instrument confronté au volume dégagé par l'ensemble de la
percussion a dû signer son déclin. Aux premiers temps de la Carabalí
Isuama, elle par Joaquín Infante, l'un des fondateurs du
groupe.
Une chanson de la Isuama atteste de l'utilisation de la flûte
dans les défilés caranbalí :
|
Castillan de Cuba |
Français |
|
Toca la
flauta caliente |
Joues de la
flûte avec brio |
Vidéo : Répétition de la Carabali Olugo, Santiago de Cuba, 2009 © D.Mirabeau
Vidéo : Répétition de la Carabali de Guantanamo, 2016 © D.Mirabeau
Liens pdf : Partition de la polyrythmie de la caranbalí Isuama
Partition
de la polyrythmie de la caranbalí de Guantanamo

Chanteuses
de
la Carabali de Guantanamo ©
Miguel Angel García Velasco
Les
chansons font partie des éléments essentiels d'un groupe de
défilé. La qualité de l'exécution des mélodies par les musiciens,
le goût et de la capacité du public à se les approprier, sont
les facteurs d'une prestation réussie. On entend dans les
formations de carnaval les fragments des airs populaires du
moment, des dernières nouveautés aux standards favoris des
urbains. Ce n'est pas le cas pour les carabalí qui possèdent
un répertoire de chants originaux. A l'époque moderne, peu ou pas
nouveautés d'un carnaval à l'autre, le principal objectif des comparsas
carabalí étant de préserver les traditions. Certains airs
sont très anciens et remontent à la création des comparsas
carabalí. Comme nous le verrons par la suite, les chansons
de l'époque étaient en résonnance avec l'actualité. De nos jours,
il s'agit plus de maintenir un répertoire ancré dans l'histoire.
Les seuls chants en connexion avec l'époque moderne sont ceux à la
gloire du socialisme et de Fidel Castro Ruz.
Les chansons
comprennent des formats variés, de quelques strophes, à de
longues histoires comparables aux épopées et chansons de gestes
du moyen-âge. Durant leur arrêt face à la tribune des officiels,
les carabalí bénéficiaient d'un temps de passage qui
leur permettaient de développer des
chants et des évolutions chorégraphiques conséquentes. Ce n'est
plus le cas avec la montée en puissance des congas, la
multiplication des groupes et l'évolution des carnavals. Pour
contenter toutes les formations, quelques minutes de prestation
sont accordées à chacune. Les anciens textes sont depuis
remaniés, au profit de formats plus courts.
Les seuls chants qui nous sont parvenus sont ceux du registre
profane, utilisés pour les sorties des comparsas. Ceux
du domaine religieux ont tellement été occultés pour ne pas
attirer l'attention des autorités à l'époque coloniale qu'ils se
sont perdus. La majorité des textes sont en castillan, seule
langue autorisée quand les carabalís chantaient lors de
leurs sorties dans les mamarrachos. Quelques mots de
racine africaine ont subsisté malgré tout.
Orlando Aramis,
chef du chœur de la Carabalí de Guantanamo, a réafricanisé les
chants. Orlando est membre d'une confrérie abakuá de
Matanzas et chanteur professionnel. Il percevait une urgence à
faire ressurgir l'efik dans son milieu d'origine, quelque
soient les critiques et les difficultés. Mais ceci n'a
vraisemblablement duré que sur le temps de la direction
d'Orlando[110].
Les choristes se plaignaient de ne rien comprendre à ce qu'ils
chantaient et la présidente de l'association essuyant les
quolibets du public.
Pour les chansons de la Olugo et de la Isuama, elles sont pour
la plupart dans le mode majeur, quelques-unes en mineur. Aucune
n'utilise d'échelle pentatonique tels que dans d'autres
répertoires afro-cubains. Les airs ont l'aspect gracieux des
romances espagnoles et des contredanses européennes du XIXe
s. La juxtaposition avec les polyrythmies africaines leur donne
cette saveur si particulière Nous pouvons supposer qu'avant la
création de la Isuama, les cabildos de nación
carabalí défilaient avec des airs plus ancrés
mélodiquement avec l'Afrique. Des vagues d'interdictions et de
répressions ont fait disparaitre les signes d'africanité au
chœur même les mélodies. Seule la carabalí de Guantanamo
chante sur des échelles pentatoniques, avec des mélodies
rappelant celles des confréries abakuá.
Analyse des textes des chansons
Certains textes
des chants des carabalí font parfois référence à
l'histoire du cabildo, d'autres à des évènements dans la vie
politique, ainsi que des litanies d'ordre religieux. Les
citations de l'Afrique sont également nombreuses. Elles
l'évoquent comme un éden perdu et sont une manière de
revendiquer son origine ethnique.
Parmi les chansons les plus anciennes qui nous sont parvenues,
la suivante est interprétée pendant la obbia. Sont
citées dans le texte les saintes patronnes protectrices du cabildo.
Pendant un carnaval du début des années '80, la chanteuse
soliste serait entrée en transe à vouloir l'exécuter[111].
Cela témoigne son engagement spirituel et de son implication
dans la tradition par rapport à un texte pouvant paraître anodin
pour un novice.
|
Castillan de Cuba |
Français |
|
Yo
soy congo, carabalí Allá
viene Ma' Francisca[112] |
Je
suis congo, carabalí |
Les deux strophes suivantes
témoignent de l'importance de nommer ses racines africaines.
Nous noterons l'hétérogénéité des populations africaines citées
dans les paroles. Elle s'explique au regard de la fin des
cabildos de nación et de leur transformation en
« sociétés d'entraide mutuelle ».
|
Castillan de Cuba |
Français |
|
Yo
soy africana pariente de lucumí |
Je
suis africaine parente de lucumí |
Parfois des strophes
entières sont dans une langue incompréhensible proche de
dialectes africains. La prononciation originelle a été
transformée au crible du castillan, opacifiant la compréhension.
Ce sont des extraits de liturgies, dont l'emploi a pour but
d'être un marqueur d'africanité. Extrait d'un chant de la
Isuama.
Iyá samfaramfa
Iyá takilao[114]
Ceremi ceremi
Guarandabia ceremi[115]
Aniba barroco
Ekuenté monina
Aniba barroco[116]
Comme évoqué précédemment, la Carabalí de Guantanamo interprétait encore ces dernières années des chants aux racines africaines très marquées. La majorité du vocabulaire est en efik, langue du Calabar, encore utilisée dans les potencias abakuá à Cuba.
Nous
ne proposerons pas de traduction pour le texte suivant. Peu de
mots en castillan. Tous ceux en efik font référence aux
mythes fondateurs des abakuá, aux secrets, aux instruments de
musique, artefacts de pouvoir et religieux. Le texte est
d'Orlando Aramis Brugal Suarez.
Oleya, oleya
Golpe a golpe de mi ritmo espiritual
Oleya, oleya
bonkó
Golpe a golpe de mi tumbo espiritual, brícamo!
Oleya carabalí,
oleya enchemiya
Golpe a golpe de mi ritmo espiritual
Carabalí soy
yo, carabalí soy yo
Carabalí brícamo, carabalí soy yo
Carabalí mayenefík, carabalí brícamo
Carabalí mayenefo, carabalí soy yo
Abasi abasi, si
kuane kua sika
Si caney kua sika, si kuane kua sika
Si caney kuasi nganga, si kuane kua sika
E liba liba
enkamá, si kuane kua sika
E oro viví, o nganga viví, si kuane kua sika
E liban ngang o bongo meta e, si kuane kua sika
Ekwe ta ya
bonkó, ekwe ta ya bonkó
Yeye yeye men kamá, ekwe ta ya bonkó
Abasiango me abasien kwame
Yayo yayo mahe, ekwe ta ya bonkó
Abasi yayo mahe, ekwe ta ya bonkó
E kuenda ya
bonkó, e kuenda ya bonkó
Bricamo yayo, yayo ma e, e kuenda ya bonkó
E wa yo, wa yo ma e, e kuenda ya bonkó
Ba liba, ba liba ba liba venga ma, e kuenda ya bonkó
E liba ngangando así kane kwa, e kuenda ya bonkó
E odua apapa condo mina me fe, e kuenda ya bonkó
Yambao eluman viene, eluman viene
Eluman viene, eluman viene
Ekó bio elu, eluman viene
Elo viví, eluman viene
E ibibio, eluman viene
Bricamo mayene, eluman viene
Eye me fi, eluma viene
E me kwama, eluma viene
E iréme, eluma viene
Carabalí, eluma viene
La chanson qui suit parle à mots couverts de l'esclavage et de
l'importance de se divertir pour échapper un temps à ses
conditions de vie difficiles. Transmise par Yailín Durán
González responsable de la Isuama Infantíl.
|
Castillan de Cuba |
Français |
|
Coge
el golpe a mi tambora |
Il
donne des coups à ma tambora Je
suis carabalí |
Le chant de
obbia suivant est exécuté pour clore un défilé, après la moyugbación,
où sont cités tous les membres fondateurs du cabildo.
Pendant cette obbia, la Carabalí salue le
public en s'éloignant. Nous noterons l'emploi de vocables issus
du champ lexical lucumí mêlé au castillan.
|
Castillan de Cuba |
Français |
|
Ekó[120]mi
tambor |
Eko,
mon tambour vous salue |
Si
le contenu des chants de carabalí relate les traditions
et les évènements historiques passés dans les défilés
contemporains, ce ne fût pas toujours le cas. Dans les premières
années des cabildos Isuama et Olugo, ils étaient ancrés
dans le quotidien de l'époque. Le peuple des petites gens, dont
sont issus les cabildos, ne ménageait pas les
gouvernements dans leurs chansons. Les manifestations
carnavalesques ont toujours été un espace d'expression de la
parole populaire, une « catharsis des opprimés[124],
donnant lieu ensuite à des mesures répressives. L'engagement des
carabalí dans les guerres de libération, laisse supposer
également leur liberté de ton. Cette fronde verbale continuera à
s'exprimer pendant la pseudorépublique[125].
Les strophes suivantes font référence à la dérégulation des salaires de 1902, autorisée par le président Tomás Estrada Palma, peu après la proclamation d'indépendance et du sentiment du peuple de s'être fait avoir, après avoir lutté pour la liberté.
|
Castillan de Cuba |
Français |
|
Cuba,
Cuba lo cubano |
Cuba,
Cuba, les Cubains |
Comme beaucoup de chants de carnaval crées
juste après la révolution castriste, ceux des carabalís
sont des relais de propagande à la gloire du nouveau régime
politique. La parole publique est alors entièrement sous
contrôle. Les deux paragraphes suivants narrent les exploits de
Fidel Castro (la caserne de Moncada en 1953), sa capacité à
mener le peuple à la révolution et au changement de régime en
1959.
|
Castillan de Cuba |
Français |
|
Hay
un cubano coloso |
Il y a un
colosse cubain |
Cabildos et comparsas carabalí
- Cabildos transnacionales: Rituales en Movimiento y
Experiencias Procesionales en Cuba y Puerto Rico del Siglo XXI,
José Manuel González-Cruz, 2018, Université de Brasilia
- Comparsa Carabalí à Guantanamo, Daniel Mirabeau, 2016,
Ritmacuba, http://www.ritmacuba.com/comparsa-caranbalí-Guantanamo.html
- El cabildo Carabalí
Isuama, Nancy Perez Rodriguez, Editorial
Oriente, 1982, Santiago de Cuba
- El cabildo Carabalí
Viví, allianzas y conflictos por el derecho a la libertad,
Santiago de Cuba. (1824-1864), María de los
Ángeles Meriño Fuentes y Aisnara Perera Díaz, Instituto de
Investigaciones de la Cultura Cubana Juan Marinello, 2010, La
Habana
- El cabildo Carabalí Viví
de Santiago de Cuba (1797-1909), María de los
Ángeles Meriño Fuentes y Aisnara Perera Díaz, Editorial de
Oriente, 2014, Santiago de Cuba.
Carnaval à Cuba
- Cuban festivals, a century of afro-cuban culture,
Judith Bettelheim, I.Randle Publ.
- El carnaval santiaguero, Nancy Perez Rodriguez
vol.1 & 2, Editorial Oriente, 1988, Santiago de Cuba
- Le Carnaval à Cuba, Patrice Banchereau, 2012, éd. La
Meca.
http://www.lameca.org/publications-numeriques/dossiers-et-articles/le-carnaval-a-cuba/
- Los grupos folklóricos de Santiago de Cuba, José
Millet & Rafael Brea, Editorial Oriente, 1989, Santiago de
Cuba
- Performing Afro Cuba, Kristina Wirtz, Chicago press,
2014
- Répertoire
chanté du carnaval cubain, Daniel Mirabeau,
2014, Ritmacuba, http://www.ritmacuba.com/Cancionero-carnaval-Cuba.html
- Solo con Los Hoyos, Conga
Music and Re-Membering Community in the African Diaspora,
Alexandra P. Gelbard, Michigan State University, 2013
Aspects musicaux des comparsas carabalí
- Del areito y otros sones, p.118. Marta
Esquenazi, 2007, Ed. Adagio
- Diccionario enciclopedico
de la musica en Cuba, Radames Giro, Letras
Cubanas, 2009, Santiago de Cuba
- Discursos músico-sociales
e identidad: tipos genéricos en la música popular festiva de
dos cabildos santiagueros, Yianela Pérez Cuza,
Instituto Cubano de la Música, 2012
- Instrumentos de la Música Folclórico-popular de Cuba,
1997, CIDMUC
- La percusión en los ritmos cubanos, Mililian Galis
Riverí, 2017, Ed de Oriente
- Musiques
cubaines, Maya Roy, Actes Sud, 1998
- Ritmos de Santiago de
Cuba, Juan Bauste/Mark Collazo, Bongo Shop,
2009, Frankfurt
Les confréries abakuá et les sociétés Brikamo
- Presencia de la sociedad abakuá en Fernando Poo a
finales del siglo XIX, Isabela de Aranzadi, 2014, Batey
N°5
- The voice of the
leopard, african and secret societies in Cuba,
Ivor Miller, Missisipi University Press, 2009
-
Dialogos imaginarios, Rogelio Martinez Furé, 2016, Letras
Cubanas
en ligne Imaginary
Dialogs : Rogelio Martínez Furé. English
translation (Barry Cox) : Bríkamo
Site ritmacuba.com
Les cabildos de nation à Cuba
- Del cabildo de nación a la casa de santo, María del
Carmén Barcía Zequeira, Fondation F.Ortiz, 2012
- Diccionario
provincial casi razonado de voze y frases cubanas, Esteban
Pichardo, 1836, Santiago de Cuba
- El Cabildo congo de Santiago de Cuba, Elsa Isabel
Malaguer Andreu, thèse de maîtrise, Université d'Oriente, 2010.
- La sociedad colonial de
Santiago de Cuba (1780-1803), José Luis Postigo
Belmonte, Memorias N°2, 2010, Colombia
- La Tumba Francesa, Daniel Chatelain, Revue Percussions N°46
& 47, 1996, Chailly en Bière. http://www.ritmacuba.com/La-tumba-francesa-D_Chatelain.pdf
- Los
cabildos africanos y sus descendientes en Matanzas, Marta
Silvia Escalona, 2008, Matanzas
- Los cabildos africanos en Camagüey desde el siglo XVII al
XIX, Consuelo A. Sánchez Viamontes. http://www.pprincipe.cult.cu/los-cabildos-africanos-en-camaguey/
- Los cabildos negros santiagueros, Olga Portuondo
Zúñiga, Del Caribe N°32, 2000, Santiago de Cuba
- Los cabildos y la fiesta
afrocubana del Día de Reyes, Fernando Ortiz, ed.
Ciencias Sociales, 1921, La Habana
- Los Ilustres apellidos : negros en La Habana colonial,
María del Carmen Barcia, ed. Boloñas Sciencias Sociales, 2009,
La Habana.
- Yo soy el otro, los
Cabildos de Nación en La Habana, Luisa M.
Martínez O'Farrill, Instituto Cubano de Antropología, 2008, La
Habana
L'économie de plantation à Cuba
- Cuba,
terre et esclaves,
Sidney W.Mintz, Études rurales N°48, éd. Persée, 1972, Paris
- El ingenio, complejo económico social cubano del azúcar,
Moreno Fraginals, 2001, Ed.Crítica
- Esclavage et économie de plantation à Cuba, Esla Capron, 2014,
PUF
Traite transatlantique, esclavage à Cuba
- Atlas
des esclavages,
Marcel Dorigny & Bernard Gainot, éd. Autrement, 2013, Paris
- Esclave
à Cuba, Miguel Barnet, Gallimard, 1967, Paris
- Esclavage et modernité à Cuba, la réception du traité de
législation de Charles Comte, Karim Ghorbal, 2014, PUB
- Les routes de l'esclavage, Catherine Coquery Vidrovitch, 2018,
Albin Michel
- El monto de la inmigración forzada en el siglo XIX, La
Habana, J.Pérez de la Riva,
E. De Siencias Sociales, 1979
- La sociedad colonial de Santiago de Cuba, José Luis
Belmonte, 2005, Universidad del Norte
- The Kongolese Saint Anthony : Dona Beatriz Kimpa Vita and
the Antonian Movement, 1684-1706, Thornton, John K.,
Cambridge University Press, 1998.
- Una aproximación a la trata esclavista en Cuba
1789-1820, José Manuel Fernandez, 2001, Asociación Española de
Americanistas
Cuba à l'époque coloniale
- Biografía de la pirueta santiaguera, Manuel
Palacios Estrada, 1946, Santiago de Cuba, Inédit
- D'une île rebelle à une île fidèle, Agnès Renault, PURH, 2012
- L'île de Cuba, Hippolyte Piron, 1876
- Pearl
of The Antilles or An Artist in Cuba, Walter Goodman, Londres, H.S.King & Co. 1873
Mouvements d'émancipation et guerres d'indépendance
- Cimarronaje y rebeldia, Rafael Duharte, Del Caribe
N°3, 1984.
- La
longue guerre des nègres marrons
à Cuba, Alain Yacou, éd. Karthala, 2009, Paris
Les Noirs et Créoles à Cuba
- Cuba en couleur, Cuba en Noir et Blanc, Didier Laurencin,
2015, Inédit
- El ascenco social del
negro en la Cuba colonial, Rafael Duharte
Gimenez, Buletin Americanista N°38, 1988, Barcelona
- Les Noirs à Cuba au début du XXe siècle, Marc
Séfil, 2010, L'Harmattan
- Pardos y morenos esclavos y libres en Cuba y su
instituciones en el Caribe Hispano, Rafael Lopez L.Valdés,
C. in Estudio Avanzado de Puerto Rico y el Caribe, 2007, San
Juan
- Résistance
et mémoire des esclavages, Didier
Laurencin, Olivier Leservoisier, Khartala, éd, 2014, Paris
- Sobre prejuicios, dependencias e integracion. El
liberto en la sociedad santiaguera. 1780-1803., José Luis
Belmonte, Memorias N°2, Colombie.
- Una temprana cofradía vodú en Santiago de Cuba, Olga Portuondo Zuñiga, 2011, Del Caribe
N°55.
Les racines ethniques africaines à Cuba
- Atlas etnográfico de Cuba, Collectif, 1999, Fond.
Juan Marinello, La Havane
- Africanidad y
etnicidad en Cuba, Jesus Guanche, Editorial de
Sciencias Sociales, 2011, La Habana
- Glosario de afronegrismos, Fernando Ortiz, 1924
- Carnaval en Santiago, LP Siboney 212, 1959, LP
- Carnaval in Cuba, LP Ethnic Folkways FE4065, 1981, LP
- El ritmo tradicional de Cuba, Orquesta Típica de
Santiago de Cuba, Academia Royal, 2013, CD
- La musica del pueblo de Cuba : "Canto funeral (Carabalí
Izuama)", enregistrement in situ 1964, Areito LD-3440/1,1974,
double LP.
- Ritmos cubafricanos vol.1, Cutumba, Academy of Cuban
Folklore and Dance, 2005, CD
"Canto
funeral (Carabalí Izuama)" - LP Areito
A Daniel Chatelain pour sa relecture, conseils, suggestions et
critiques.
A Patrice Banchereau pour ses traductions de chants en efik
et ses conseils
Aux membres de la Isuama, particulièrement Yailín Durán
González, directrice de la Comparsa infantíl
Aux membres de la Carabalí de Guantanamo, particulièrement
Orlando Aramis Brugal Suarez
A Kristina Wirtz, Irene Cruz Gilbert, Miguel Angel García
Velasco, ethnologues, pour le prêt de leurs photos.
mirabeaudaniel[at]gmail.fr
© Daniel Mirabeau & ritmacuba.com
Egalement sur ritmacuba.com :

A la source ? | Qui sommes-nous ? | Nos partenaires
© Ritmacuba 163 r. de la Butte Pinson 93380 PIERREFITTE - FRANCE Tél : +33 1 48 39 90 53 / +33 6 21 34 53 25